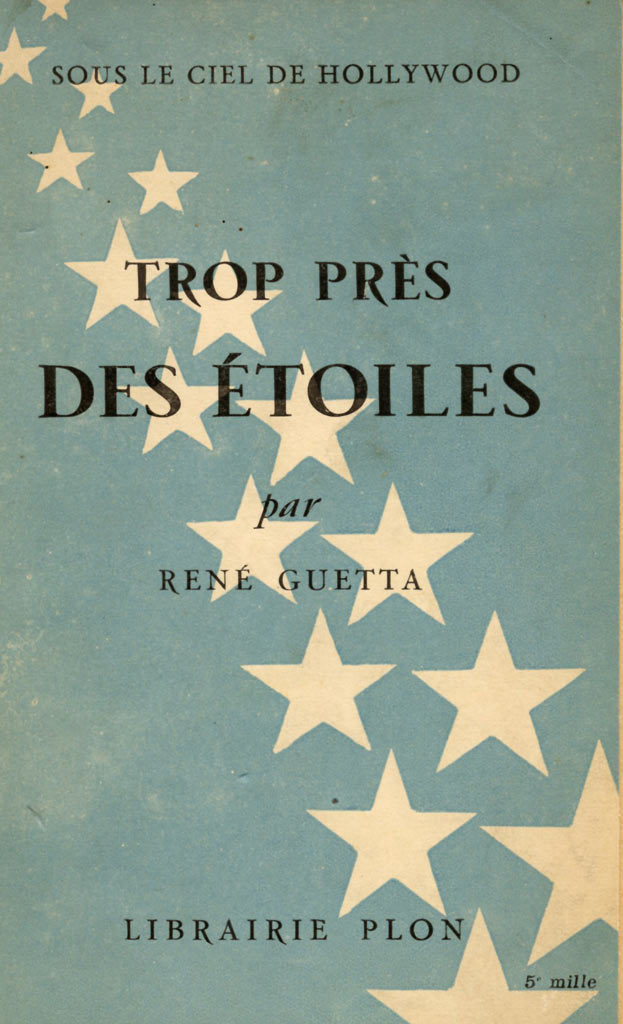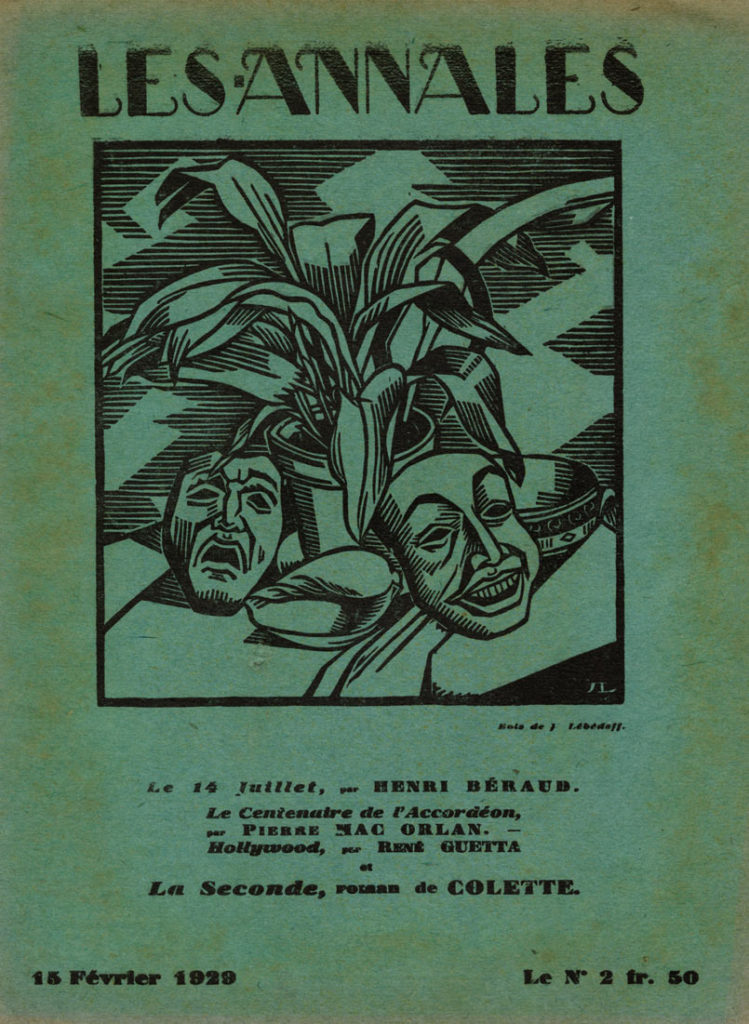Clappique / René Guetta / Hugo Stipsitz
On a déjà beaucoup écrit sur Clappique jouant avec la mort dans La Condition humaine, et que les Antimémoires montrent résidant en 1965 au Raffles à Singapour… Dans un article publié dans Le Figaro en 1968, Henri Muller avait apporté la précision suivante : «L'homme qui a inspiré ce Clappique, je l'ai bien connu. Il amusait Malraux, comme il a amusé tous ses amis, par sa façon de s'exprimer, par ses dons d'imitateur, par la vie pittoresque, bohème et nimbée de whiskies qu'il menait. Il s'appelait René Guetta (dit Toto), il était israélite, ne mesurait pas plus d'un mètre soixante et avait, je cite Malraux, “un profil de furet”.» (Voir OC3, 281.) Muller précise que René Guetta est mort, peu après la seconde guerre mondiale, en Afrique.
René Guetta avait aussi été l'auteur de quelques romans dont l'un (Trop près des étoiles. Sous le ciel d'Hollywood) raconte le désabusement d'un narrateur désœuvré («Maintenant je me rends compte combien je devais paraître bizarre à tous ces braves gens ; peut-être ne s'en sont-ils pas rendu compte ; peut-être ont-ils dit : “Encore un idiot !”») et l'échec de son ami le «comte blond» à se faire un nom à Hollywood («Que savait-il faire ? Quelle expérience avait-il ? Ecrivain ? Il ne savait pas écrire. Acteur ? C'était un homme du monde.»). Dans les Antimémoires, Malraux note que Clappique «a de nouveau travaillé à Hollywood […]» (OC3, 281.)
Un autre modèle du Clappique de la Condition (qui a inspiré Malraux pour l'histoire de son grand-père enlevant une écuyère) se nommait Hugo Stipsitz, «aristo décavé, échoué à Montparnasse, originaire de la localité de Ternova (Transylvanie)» et qui se faisait appeler baron Ternova. Une lettre inédite du 22 janvier 1953, signée «votre Clappique (Insbruck, poste restante)» envoyée par «Hugues Ternova» se trouve dans les archives de la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
Ce qui est assez bluffant dans la carrière de Guetta, c’est que sans avoir été acteur (sauf de sa propre vie), il a eu droit à une étoile sur Sunset Boulevard. Sur le trottoir d’en face, c’est Clappique qui l’a eue, à force de persuasion et de pression sur ses amis californiens.
Nous avons retrouvé plusieurs textes signés René Guetta que nous proposons ici. Outre ses deux principaux ouvrages «Sous le ciel d’Hollywood Trop près des étoiles», (1929) et «L’Ile sans rêves» (1931), voici des extraits du premier ouvrage et d’autres articles de l’écrivain farfelu.

«Pas un mot. Tarare Pompon! Rentrez sous terre !»
1929
1931
1(*[1]) Extrait de Plus près des étoiles
Le comte blond me dit :
— Nous partons demain.
— Ah !… Tu as décidé ça ?…
— Oui !… C'est le 1er avril. Une plaisanterie. tu ne trouves pas !
Je n'étais pas convaincu. En fait de plaisanterie, traverser toute l'Amérique, de l'Atlantique au Pacifique !…
La longueur du trajet m'épouvantait. J'étais, à New-York, suffisamment loin de mon pays pour n'avoir pas envie de m'éloigner davantage ! J'hésitais.
– Allons, reprit le comte blond. Ne fais pas d'histoires. Cela va être follement intéressant…
J'étais sceptique. Je suis toujours sceptique quand il s'agit de l'inconnu. J'ai, depuis bien longtemps, appris que les voyages ne sont pas tels qu'on nous les a décrits. Mais le comte blond était optimiste.
— Comment, mon cher, tu fais des manières ? Voir toute l'Amérique d'un jet !… L'Illinois ! le Kansas ! le Colorado ! le New-Mexico ! l'Arizona ! la Californie ! Qu'est-ce qu'il te faut ? Et la fortune après, ajouta-t-il d'un air grave.
Son grand corps aux épaules larges, à la taille mince, était secoué pas l'électricité de son enthousiasme. Peu à peu, à mesure qu'il parlait, son excitation s'infiltra en moi et, comme un bon air de jazz, me conquit tout à coup.
— Tiens, ajouta-t-il, regarde… Si tu n'es pas tenté après cela, je pars seul…
Il déplia un journal, me mit sous les yeux un article, les phrases suivantes soulignées : «Hollywood est la seule ville des Etats-Unis où les mœurs soient vraiment libres et où il est possible de mener la grande vie. Ses orgies peuvent se comparer aux orgies du gay Paree, etc…»
Le comte me regarda triomphalement.
— Et bien ! hésites-tu, maintenant ?…
Tentant, en vérité, la Californie ! Pourquoi pas, après tout ? Et puis, n'aurais-je pas, en France, le prestige du monsieur qui connaît des pays étranges ? Je vois d'ici mes amis lorsque je leur parlerai de Hollywood.
— Comment est-ce que ?… Tu connais Douglas ?… Quel âge a Ronald Colman ? Et Charlot ?…
Le comte lut dans mon regard qu'il avait gagné. Ce n'est que pour la forme qu'il me demanda sans sourire, délicatement, pour ne pas me faire sentir que j'acceptais :
— Alors ?…
— Eh bien ! Je pense que tu as raison. A la réflexion, j'aime autant tout connaître pendant que je suis dans ce pays. Qui sait quand j'y reviendrai !
—Bravo. Je vais tout de suite m'occuper des billets. Et tu verras que tout se passera admirablement.
— Au revoir ! A demain, cinq heures.
II
De la manière d'arriver à Hollywood
L'excitation de l'arrivée secoue nos regrets; d'ailleurs, même sans excitation, l'arrivée est charmante. A peine sortis du train, la petite gare de Los-Angeles vous accueille, semble-t-il, avec une sorte de douceur. Et Dieu sait si c'est rare d'être accueilli avec douceur en Amérique ! On quitte l'énorme Grand Central de New-York et on arrive dans une espèce de petit chalet campagnard comblé de fleurs et de soleil. On a le sourire satisfait du monsieur qui, ayant quitté son bureau avec la migraine, arrive dans sa maison de campagne de Normandie. Car la gare de la grande ville de Los-Angeles est une toute petite gare qui a l'intimité des toutes petites choses.
Tout de suite, la chaleur cordiale de ce pays gai vous saisit, et, comme dans notre Midi, tout paraît être de bonne humeur. Il y a comme un air de vacances. Costumes clairs, pas de chapeaux, teints brunis.
Les porteurs sont loquaces.
— Bon voyage ?… Oui ? Tant mieux ! Il fait beau, hein, ici ?… C'est mieux qu'à New-York ?…
Les gens de l'Ouest ne peuvent pas souffrir les gens de l'Est, et ils sont ravis quand ils peuvent faire des allusions qu'ils croient piquantes. J'ai apprécié, d'ailleurs, ces discours qui m'ont rappelé ceux que font, à Paris, les chauffeurs de taxis à moustaches, lesquels ont toujours la conversation facile et le langage imagé.
— Tiens, il y a une célébrité dans le train, remarque l'homme, de l'air apaisé de celui «qui en a vu d'autres».
Effectivement, sortant d'on ne sait où, une nuée de photographes se sont rués sur le compartiment 485. Un petit jeune homme en sort, le plus naturellement du monde.
— Hello, boys, crie-t-il en souriant. Me voilà. Je suis bougrement content de voir votre Californie !
Vingt déclics. Le petit jeune homme continue, s'adressant aux journalistes, qui notent :
— J'ai le plaisir d'être dans les murs d'une ville dont les progrès, à tous les points de vue, ont fait d'elle une des plus importantes de nos Etats-Unis et du monde.
Il descend. Les journalistes, satisfaits, se coagulent autour de lui. Un autre groupe entoure ce groupe. Un géant brandit une énorme sur laquelle ces mots sont écrits en grandes lettres noires : «T… est dans la ville.» Docile, T… se laisse entraîner, sous l'œil intéressé des porteurs nègres, et sous l'œil approbateur des Californiens.
— Qui est-ce ?
— Nous le saurons demain, me répond sagement mon porteur.
Nous suivons le groupe. Dehors, attendent cinq rolls-royce; l'homme à la pancarte s'installe dans la dernière, le petit monsieur tout seul dans la première. Une foule d'amis hurlants s'empile dans les autres. Ce héro a le regard tranquille; on dirait qu'il a l'habitude. Nulle émotion, nul sens du ridicule ne marquent sa figure d'un trait spécial.
Aux deux agents motocyclistes qui gardent la voiture, il fait un geste de la main. Puis, les autos s'ébranlent, dominés par la sirène de la police qui couvre de ses ailes protectrices cet important personnage.
— Il doit être très connu, demandais-je.
— Oh !… ce ne sont pas les plus connus qui ont le plus besoin de publicité, vous savez.
Je me tourne vers le comte, qui n'a pas encore dit un mot. Il regarde avec un regard bleu, un peu lointain, la caravane qui s'éloigne triomphalement.
— Nous faisons purée, finit-il par dire, en montrant notre taxi qui attend.
— Mon cher, il n'y a que deux manières, m'a-t-on dit, d'arriver à Hollywood. 1° En faisant un tam-tam de tous les diables de publicité, ce qui doit être assez fréquent ici. 2° En arrivant comme des malheureux, ce qui est notre cas, et ce qui doit être la dernière des choses à faire si l'on veut se lancer dans le cinéma.
— Mais on ne peut pas faire de publicité si on n'a aucun titre pour en avoir.
— Toi, tu en as un, ce me semble, tu es comte.
— Ne fais pas d'esprit. Ce type qui vient d'arriver est soit un acteur, soit un auteur très connu, ou encore un financier. La manière dont il a parlé prouve déjà une autorité formidable. D'ailleurs, on n'enverrait pas la police arrêter la circulation devant les pas de n'importe qui. Alors, tu me fais rire avec ta publicité.
J'avais pourtant raison, instinctivement. J'ai appris plus tard que rien n'était plus facile d'obtenir qu'un peu de réclame fût faite autour de vous. La ville du cinéma est une ville spéciale. Les acteurs, même les tout petits acteurs, intéressent les populations. Tout le monde est avide de nouveauté, et il n'y a presque qu'à envoyer un mot annonçant son arrivée pour avoir des journalistes et des photographes à la porte du wagon. C'est à eux de se débrouiller après.
Mais ils trouvent toujours de quoi remplir leur papier. Un de mes amis, inconnu dans la ville, je le sus plus tard, n'avait-il pas envoyé une prime de cinquante dollars à celui qui le photographierait en premier ?… Il eut vingt professionnels et vingt reproductions de sa personne… Il était connu.
Mais la personnalité du petit monsieur m'intriguant, j'eus bientôt la preuve de ce que je soupçonnais. Le lendemain, en ouvrant le Los Angeles Examiner, je suis tombé sur trois photos de lui et sur deux articles. C'était un champion de tennis de table… Quant à sa fortune, elle se montait à treize sous; mais ce dernier détail, les journaux avaient omis de le donner.
III
Hollywood
Hollywood est une ville qui se trouve à l'extrême ouest des Etats-Unis, tout près de Los Angeles, dans la province de Californie, sur l'océan Pacifique.
Si je me permets de donner cette explication, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui ont vu cette ville alors que le monde entier connaît le nom de ses principaux habitants. Qu'un professeur de géographie demande à n'importe lequel de ses élèves, fût-il Chinois :
— Qu'est-ce que Hollywood ? Quelle est la grande industrie de Hollywood ?
On lui répondra :
— Hollywood est la «capitale du cinéma», lequel cinéma est son industrie dominante. Quant aux indigènes, ils se nomment : Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Gloria Swanson, etc…
Pourtant, c'est un tout petit coin, éloigné de toutes les parties du monde par des semaines de bateaux et des journées de chemin de fer; mais ce petit coin saillit, dans la mémoire des hommes, autant que Paris, Londres ou New-York.
Hollywood veut dire «Bois de houx.» Nul ne saurait dire pourquoi et je vous affirme qu'on n'y trouve pas de houx. C'est une ville charmante, étalée sous un ciel perpétuellement bleu. Personnellement, j'aurais mieux compris : «Palmwood», les palmiers y étant les plus beaux du monde. Enfin, supposons qu'il doit y avoir une raison ancienne que je ne connais pas, et qui justifie ce nom. Hollywood est enchâssée dans de petites collines. De larges routes bitumées, brillantes sous le soleil, la coupent en sections symétriques, régulières, comme dans toutes les villes américaines. Contrairement à ce que, naïvement, j'imaginais, Hollywood est grand et ne se compose pas seulement de quelques rues. Je pensais, en effet, me trouver dans une espèce de village, entouré de tous les côtés de studios contigus. J'avais souvent rêvé d'entrer, comme dans un théâtre, dans la «cité du cinéma», et de côtoyer, ébloui, des cow-boys qui tirent des coups de revolver dans les rues, Douglas Fairbanks en train de sauter du sixième étage d'une maison, Menjou en habit, Novarro tout nu, et, enfin, de tomber en extase devant des femmes au maquillage mauve, de qui j'étais amoureux depuis des années. J’avais rêvé de rues encombrées de projecteurs, d'hommes à porte-voix, en manches de chemise, et d'appareils aux regards noirs et enregistreurs.
J'eus, en quelque sorte, une manière de désillusion, en voyant que Hollywood était une ville comme les autres villes californiennes. L'angoisse de me trouver dans un monde différent de celui auquel j'étais habitué disparaissait.
Je viens de dire que c'est une ville comme les autres. J'entends par là que, comme les autres, elle contient de larges avenues, de grands hôtels, des drugstores, des banques, des tramways, de grands magasins, des écoles, des théâtres et des cinémas bien entendu; mais, comme dans bien des villes de l'Ouest, il n'y a pas de poussière, pas de métro, pas d'elevated, qui sont ces infâmes trains suspendus qui empêchent les gens de dormir tranquillement. Tout, à Hollywood, est campagnard et gai, couronné d'un perpétuel soleil. Pas d'usines qui de leurs cheminées pourraient noircir le ciel si pur. On sent, dès l'arrivée, une ville neuve, jaillie entre le désert et l'océan.
Les vieillards vous racontent souvent les souffrances, les luttes et les fortunes que rencontrèrent, il y a un siècle, les chercheurs d'or au même endroit. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'or dans la région et la fameuse «Imperial Valley» ne s'y trouve qu'à cent milles environ.
La «rue de la Paix» de Hollywood s'appelle Hollywood Boulevard. Grande avenue droite, bourrée de magasins, de restaurants et d'hôtels, et qu'un tramway traverse. L'un des meilleurs de ces hôtels est l'hôtel Christie, qui appartient aux fameux frères Christie, auteurs de plaisantes comédies. Les deux meilleurs restaurants sont : «Le Montmartre Café», tenu par un Français, et où toutes les stars se donnent rendez-vous, et «Henry», dont le propriétaire est M. Henry Bergman. Ce nom ne dit rien, mais le public a vu bien des fois cet honorable restaurant dans les films de Chaplin, dont il est l'aide dévoué depuis une quinzaine d'années.
Henry est gros, jovial, plein de bon sens, et, en récompense de sa collaboration et de son amitié, Charlie lui a acheté un superbe bistrot. Tout le monde va lui faire visite, et presque tous les soirs, vers minuit, à une petite table déserte, Charlie Chaplin soupe tranquillement sous l'œil protecteur de son protégé, perché derrière son comptoir.
Je ne vous dirai pas les noms des nombreuses avenues. Elles se ressemblent toutes, encadrées de palmiers géants, et accumulant, de place en place, des étalages de bois sur lesquels des fleurs à couleurs vives ou des fruits disposés en pyramides prennent des bains de soleil. La vitesse en auto y est interdite, et les agents motocyclistes arrêtent impitoyablement toute personne dépassant trente-cinq milles à l'heure.
Presque tout le monde a, là-bas, une maison et une voiture. On ne paye, en effet, qu'à crédit, ce qui permet à une demoiselle de magasin d'avoir sa chrysler qui l'attend à la porte pour la déposer dans son bungalow.
Le cinéma vous a montré ces petites villas californiennes. Elles sont en bois ou en carton-pâte. De couleurs claires, roses, vertes, jaunes, elles sont couvertes d'un toit brun et n'ont fort souvent qu'un étage. Le style employé le plus fréquemment est mi-espagnol, mi-arabe; l'intérieur se compose d'un petit salon, d'une chambre à coucher, d'une salle de bain et d'une cuisine. Bien entendu, je parle de celle pour lesquelles il faut payer de cinquante à soixante-quinze dollars par mois. Sur le devant, un jardin dans lequel un palmier gigantesque veille. Téléphone, glacière et lits qui se remontent dans le mur sont de petits suppléments qu'il faut noter.
Hollywood contient des rues entières formées de petits bungalows. Du côté de Wilshire Avenue, et plus on monte vers Beverly Hills, de grands bungalows très chers se dressent. Ils ont la même disposition, mais comportent, généralement, plusieurs étages. Les gens «élégants et cultivés» se font faire des maisons de style anglais (il y en a presque autant que de style espagnol), et les gens très raffinés, des maisons de carton-pâte, devant lesquelles tout le monde s'extasie et qui sont considérées du meilleur ton, de goût français, genre «château de Versaille» en miniature. C'est le comble de l'élégance.
L'intérieur varie, d'ailleurs, assez rarement et est également mélangé. Un beau meuble Louis XVI par exemple, à côté d'une demi-douzaine de chaises «à la Martine».
De grands buildings de quinze étages, des banques solides et des grands magasins complètent la ville. Dans les rues se croisent des jeunes filles presque nues sous des robes légères, avec des bas roulés s'arrêtant aux genoux, généralement très jolies et sans chapeau; de grands jeunes gens brunis par le soleil, en chandails, également sans chapeau. Des ford, des chrysler, des rolls, des packard. On ne rencontre évidemment pas de femmes enceintes (il n'y en a jamais dans les rues, en Amérique) et peu de femmes en deuil (cela ne se porte plus).
Puis, des Liggett[2] drug-stores, des bureaux de tabac et, de temps en temps, de superbes établissements exposés au soleil, éclatants de blancheur, qui sont les «Mortuaries». Ces bâtiments, qui sont réellement les plus agréables et les plus charmants à regarder, sont des endroits où on fait embaumer et mettre en bière les morts.
Il y a deux coins où les grandes stars, les grands directeurs et les grands producers résident. Car vous pensez bien que ces demi-dieux ne peuvent être continuellement en contact avec le public. Le premier est la montagne; là-bas, en haut des collines, Adolphe Menjou, Monta Bell, le directeur de la M. G. M.; Edith Sutherland et Louise Brooks, William Wellmann, et bien d'autres habitent.
L'autre coin se trouve situé à un quart d'heure de Hollywood et s'appelle Beverly Hills; quoique ce lieu soit moins connu que Hollywood, il a l'honneur, pourtant, de contenir dans ses murs tous les as du cinéma.
En ce refuge étonnant, Doug, Mary, Chaplin, Gloria, Norma Talmadge, Marion Davies, Norman Kery, Dick Barthelmess, Corinne Griffith, etc., vivent leurs vies célèbres. De grandes maisons somptueuses, aux parcs immenses, que l'on se montre comme des demeures historiques, sont «la maison de Gloria» ou «la maison de Harold Lloyd». De grandes avenues ombragées par les palmiers immenses et pas de tramways. Une petite ville, trois banques, quelques magasins, quelques appartements, des drug-stores, sont installés dans un coin pour que les résidents n'aient pas à se déranger s'ils veulent un cachet d'aspirine ou une paire de bretelles.
Beverly Hills contient deux hôtels : l'un, somptueux, qui vient d'être construit, le «Beverly Wilshire», et l'autre un peu plus simple, plus famille, où l'on joue au tennis. Autour de Beverly Hills, des maisons se construisent, des terrains se vendent, la ville déborde, les résidents étant de plus en plus nombreux, et jusqu'à Santa-Monica, la plage du Pacifique, les terrains se meublent chaque jour d'habitants nouveaux.
Hollywood est plein, Beverly Hills est plein, Santa-Monica est plein.
Ainsi, ce coin de désert, inconnu il y a vingt ans, est devenu l'un des centres les plus actifs et les plus productifs de l'univers. Est-ce à cause du climat ? Je pense que c'est une des premières raisons. Les pionniers du cinéma choisirent cet endroit simple, ignoré, aux terrains immenses et bon marché, et surtout exposé au soleil perpétuel, pour y établir leur quartier général. Puis, il y eut le côté mystérieux de cette terre où s'ébattent, où travaillent tant de gens célèbres que l'on voit si souvent en images et de qui l'on ne connaît rien.
Les stars. Comment vivent ces artistes de l'art muet ? Que font-ils des énormes salaires annoncés ? Quelles sont ces fêtes magnifiques, ces femmes étonnantes ? Tout attire, fascine, et, peu à peu, l'immigration commence.
Pour beaucoup, aller à Hollywood, c'est aller au pays du rêve. Peut-être cette ville, qui a tenté tant d'êtres humains, où les palmiers sont monstrueux, où les avenues sont larges, d'où le soleil n'est jamais absent, où les maisons sont confortables, peut-être cette ville est-elle trop belle pour être bonne, comme ces fleurs de Californie si grosses et qui ne sentent rien.
IV
Les nuits de Hollywood
Orgies sur Orgies…, la grande vie…, etc… Tout ce que j'avais lu, tout ce que le comte blond m'avait raconté, je l'ai cherché à Hollywood pendant des mois. J'ai pris la dignité du lieu pour une façade comme celle de ces cafés paisibles de Toulon qui renferment dans leur arrière-boutique une fumerie d'opium. J'ai été à la recherche d'une vaine initiation, d'un mot de passe imaginaire; et lorsque, à une heure du matin, on me renvoyait chez moi sous prétexte «qu'il était tard», j'acquiesçais d'un regard complice qui signifiait :
— Oh ! je suis au courant ! Je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. Livrez-vous à vos pratiques, quelles qu'elles soient, mais sachez que je ne suis pas votre dupe et que, bientôt, vous ne vous méfierez plus !…
Maintenant, je me rends compte combien je devais paraître bizarre à tous ces braves gens; peut-être ne s'en sont-ils pas rendu compte; peut-être ont-ils dit : «Encore un idiot.» Car je n'aurai pas été le dernier à croire que ce monde d'artistes est un monde de fous. La faute en est peut-être aux journalistes, qui continuent d'écrire les pires stupidités et les pires mensonges sur cette ville. Est-ce l'envie ? Je ne pense pas. Ils veulent conserver ainsi le fluide mystérieux qui entoure les personnalités cinématographiques.
J'ai cherché tout de suite les boîtes de nuit.
Flanqué du comte blond, tous deux plein d'assurance de deux Parisiens qui en ont vu bien d'autres, – entre la place Pigalle et la place Blanche, – nous avions décidé de nous imposer en étant plus déchaînés que les plus déchaînés, plus basés que les plus blasés, plus cyniques que les plus cyniques. Et nous sommes sortis tous les soirs, comme à Paris, pour voir.
Voici ce que nous avons vu :
Dès que le soleil se couche, les rues s'apaisent, les lumières s'allument. Dans les petits bungalows modestes, à sept heures, le dîner est servi. Déambulant devant les fenêtres, combien de fois avons-nous jeté un coup d'œil indiscret et vu, réunie autour de la table, la famille prendre son repas. L'homme est fatigué. Silencieux, il lit son journal. La femme sert. Des enfants très blonds s'agitent sur leurs chaises; la radio joue Blue Heaven, de la station X. Y. Z. Le chien aboie dans le jardin. La ford se repose au garage, tout est calme, semblable aux autres soirs, semblable aux autres bungalows.
Certes, on devine que, le samedi, la bouteille de gin sortira d'un tiroir, qu'on prendra sa petite cuite hebdomadaire. Mais les autres jours, des rues entières s'éteignent ainsi à neuf heures, et seul Hollywood Boulevard reste vivace encore. Là, il y a les cinémas, les restaurants. On se promène sous les nuits californiennes comme on se promène en province sur le mail. On passe et on repasse devant les mêmes gens qui ont l'air désœuvrés et pauvres.
Des figurants font la navette, pâle de faim, avec les moustaches bien cirées, les trous de chemises bien raccommodés, dans le cas où un metteur en scène passerait par là.
Ils se connaissent tous et s'abordent souvent :
— Tu travailles, en ce moment ?
— Non. Et toi ?
— Moi non plus !
— Je n'y comprends rien ! Surtout après mon dernier rôle. Tu n'as pas vu ? Dans Sérénade. Mon vieux, tu es aveugle. Au moment où Menjou sort de chez lui, je suis en plein dans le caméra [3]. Où vais-je, maintenant ? Je me balade… Je n'ai envie d'aller nulle part. Il fait si beau dehors.
Fausse fierté, mensonge ! Où pourraient-ils aller ? Ils n'ont pas un sou.
Les femmes qu'on croise sont ravissantes. Des colleges-girls de seize ans, fraîches et athlétiques, vous envisagent si froidement qu'on n'a pas le courage de leur parler. On marche. De temps en temps, une tête connue égarée dans une boutique. Qu'y a-t-il à faire ? Où peut-on aller ? Oui, il y a le «Montmartre». Mais il ne faut, le soir, aller au Montmartre que le mercredi. Les autres jours c'est vide et c'est bien cher.
A dîner, quelquefois, les hommes, leurs journées de studios finies, viennent y manger vivement sans beaucoup parler. Trop tard pour rentrer chez eux, ils essayent de se délasser dans ce restaurant à orchestre. Des groupes de la même compagnie s'installent aux mêmes tables. Conversation professionnelle et fatigante.
Quelques touristes espérant voir des vedettes sont désappointés. Ils ne reconnaissent pas Harry d'Abbadie d'Arrast, le metteur en scène qui dîne avec Olozabal et Limur; ni Barney Glazer au nez fouineur, qui écrit des scénarios à succès; ni Walter Wenger, qui est à la tête de Famous Players; ni von Sternberg, le directeur. Ils ne peuvent pas imaginer que ces personnages éreintés, préoccupés, sont les artisans des films qu'ils admirent et qu'ils aiment.
Et ils les laissent s'en aller à onze heures, à pas lents, pour coucher leurs idées neuves, ou leur amertume, dans le lit trop somptueux d'une trop somptueuse maison.
V
Les nuits de Beverly Hills
Dès huit heures, amoncellement de voitures devant la résidence de G. S… : rolls, packard, cadillac, minerva, même une bugatti. Le jardin immense, parfumé de plantes exotiques, resplendit de lumières. La porte d'entrée est ouverte devant la file infinie des maîtres d'hôtel à gants blancs, figés dans l'attitude décorative d'une fresque de Bernard Boutet de Monvel.
Le manteau, le chapeau, la canne, disparaissent dans leurs mains avec une précision automatique; une buée très dense de «savoir-faire» vous entoure et vous serre la gorge comme un bain trop chaud. Hollywood Boulevard est aussi loin d'ici que Paris. On est dans un cercle très fermé d'habitués et d'adeptes.
Si l'on est un professionnel du cinéma, il faut, pour pénétrer être une star ou un directeur connu; sinon, il vaut mieux dire que l'on est un gros industriel ou un amateur souriant. Les nuits de Beverly Hills sont des nuits d'étoiles; il faut avoir brillé ou il faut briller.
Je présente le comte, qui va pour la première fois dans un bal de vedettes; il est en extase devant les célébrités qui sont là en bloc. En une demi-heure, il connaît tous les dieux dont parle le monde, toutes les puissances inapprochables; les Chaplin, les Lloyd, les Gloria Swanson, les Marion Davies. Ils plaisantent, ils rient, ils boivent comme tout le monde; et le cher comte me glisse :
— Bravo ! Pour débuter au cinéma, ce n'est pas mal.
— Vous êtes depuis longtemps dans nos murs ? interroge F…, un directeur connu.
— Depuis un mois.
— Ah !… Ah !… Et vous vous amusez ?
— Mon Dieu, répond le comte habilement, je ne suis pas venu pour ça.
Froncement léger de sourcils de F…
— Vous êtes venu pour travailler ?
— Oui, le cinéma m'a toujours intéressé et…
Le comte va se lancer. Il a trouvé l'homme qui, peut-être, pourra l'aider.
— Et il vient se documenter sur place, pour écrire son prochain livre, dis-je vivement.
Le comte me regarde, ahuri. F… se retourne et, immédiatement, glisse à sa femme :
—Monsieur est un écrivain français «très connu». Permettez-moi de vous le présenter.
De lui-même, F… a augmenté mon mensonge. D'écrivain, le comte est devenu «écrivain très connu». Il se penche vers moi, de plus en plus surpris et m'entraîne dans un coin.
— Veux-tu me dire pourquoi tu as dit ça ? C'est ridicule, me dit-il en français.
— Mon cher, tu débutes dans cette «party». C'est ma cinquième. J'ai l'habitude. Il ne faut jamais dire que l'on vient faire du cinéma. Sois ce que tu voudras : homme du monde, banquier, avocat, joueur de tennis, personne ne te connaît; ils te considèrent comme égal à eux dans ton genre. Ils te mettront immédiatement à leur niveau. De connu, tu es devenu «très connu». Si tu fais du cinéma, tu es leur inférieur si grandement que cela les gêne et que, pour ne pas se déclasser ou pour ne pas être tapés d'un emploi, ils se replient dans leur coquille. Fini le prestige, même celui de l'étranger ! Sois quelque chose, quelqu'un, ou fais-le croire… comme lui par exemple !…
Et je montrais au comte le champion de tennis de table que l'on écoutait discourir sur l'utilité de jouer en revers au ping-pong…
Le comte se redresse, décidé à tout, et fonce avec témérité dans le groupe des célébrités. Le salon-fumoir se remplit peu à peu. Les cocktails innombrables, au jus de grape-fruit, circulent présentés par des valets à gants blanc.
Les invités sont introduits cérémonieusement. Ils arrivent par petits groupes, guindés, si dignes qu'ils jettent un froid. Chaque arrivée fait une pression curieuse sur les gens déjà là. Puis, la femme va «côté femme» et l'homme, «côté homme». Au début d'une party, les femmes et les hommes se séparent nettement en deux groupes distincts. Je crois que c'est la faute des hommes, qui, en dehors de leur propre femme, sont timides auprès des autres ou trop tentés. Le cher comte n'est, lui, ni marié ni timide, et la tentation ne lui fait pas peur. Il papillonne, et les maris, de leurs coins, regardent d'un œil patibulaire ce beau jeune homme qui se déploie.
Je jette un coup d'œil autour de moi. Ce sont les mêmes têtes que j'ai vues l'autre jour chez Marion Davies; et hier chez Corinne Griffith. Car à Beverly Hills, on sait exactement qui il faut inviter et quels sont ceux qu'il serait dangereux d'inviter en même temps. Vous pensez bien que les jalousies, l'envie, les racontars sont développés d'une façon très aiguë et que rien n'est plus difficile pour une maîtresse de maison que d'organiser des soirées qui se tiennent. J'ai vu G. S… rester des heures devant son papier et, aidée de deux secrétaires, combiner la soirée du lendemain.
— M, D…, bien. Mais si je l'invite, elle, il faut que j'invite aussi Harry et Eddie.
— Naturellement, madame, dit la secrétaire, scandalisée qu'on ait pu les oublier.
— Mais je ne peux pas inviter Eddie.
— Pourquoi ?
— A cause de C. W…, voyons.
— C'est vrai.
Consternation. On recommence.
— Bien entendu, vous avez marqué Helen Costello et son mari ?
— J'ai marqué Helen, madame, mais pas son mari.
— Comment ! mais il y a un mois qu'ils sont mariés…
— Oui, mais, depuis hier, ils sont en instance de divorce.
Ce n'est qu'après avoir effacé mille fois que le plu soucieux barrait le front de G… se détend et qu'elle me dit en souriant :
— Ouf !… Ca y est ! Vous, vous êtes entre Corinne et Mae. Ça va ?
Il est huit heures et demie. Tout le monde est là maintenant. La lune, par la fenêtre, jette un coup d'œil sur les étoiles. Personne n'y fait attention. La dignité, dans les cocktails, se diluent heureusement.
Les deux clans n'en font qu'un. Sur la terrasse donnant sur le jardin, des hommes en smoking fument et parlent, un verre à la main. J'ai l'impression qu'il faut faire un effort pour trouver un sujet de conversation; il y a dans toutes ces soirées trop de gens qui se connaissent bien et trop de gens qui se connaissent trop peu. La femme de l'ambassadeur et la femme du gros banquier, qui ont été invitées parce que leurs maris sont un ancien ambassadeur et un gros banquier, semblent un peu dépaysées de se trouver à côté d'une petite femme ravissante qui a débuté chez Mack Sennett et d'un gigolo à rouflaquettes sur le côté qui est en passe de devenir une grande vedette.
Non pas que leur éducation laisse à désirer : ils se conduisent tous deux divinement. Mais il est naturel qu'une bourgeoise ou qu'une ambassadrice n'ait pas la même tournure d'esprit et la même façon de voir qu'une artiste.
On peut faire la même réflexion dans tous les pays. Rien n'est plus difficile à organiser qu'une soirée mondaine et artistique. Les bourgeois veulent être trop à la page, et les artistes, trop femmes du monde.
A neuf heures, le maître d'hôtel annonce que le dîner est servi. Les portes s'ouvrent sur une énorme table, longue et mince; chacun s'installe devant l'assiette qui porte son nom. Tout est très protocolaire, trop protocolaire. Le comte m'avait parlé d'orgies !… Enfin !
Sur la table, un service très beau, éclairé par des bougies. Il est de «bon ton» de dîner «aux chandelles». Et ce paradoxe et cette affectation si franche, d'une allure désuète et démodée, donnent un certain charme à ce pays essentiellement moderne.
L'ancien ambassadeur et le gros banquier sont, ce soir, les seuls inconnus. Tous les autres se connaissent et s'apprécient.
Gloria Swanson aux yeux immenses, accompagnée de son mari; Corinne Griffith, habillée par Lanvin, avec Walter Morosco; Mae Mac Avoy, très jeune fille; Loïs Wilson, son inséparable amie, encore plus «jeune fille»; Virginia Valli, que l'on invite jamais, c'est un principe, sans ses deux camarades : Julanne Johnston et Carmélita Guérithy; Georges Fitzmaurice, le metteur en scène qui parle français aussi bien que l'anglais, et sa femme Diana Kane, sœur de Loïs Wilson; Richard Barthelmess, Harry d'Abbadie d'Arrast, Toto et le cher comte.
Sally O'Neil, Bébé Daniels et Jack Pickford; King Vidor et sa femme Eleanor Boardman; Menjou et sa femme; Norma Talmadge et Constance, sa sœur; Eddie Kane avec son inséparable œillet; enfin, Louella Parson.
Miss Louella Parson est toujours, toujours invitée. C'est, en effet, la journaliste, le critique du Los Angeles Examiner. Elle sait tout, voit tout, annonce tout. Il faut être en bons termes avec elle, si l'on ne veut pas en subir les conséquences. Ses articles sont lus chaque matin par les gens de cinéma, et cette personne souriante cache une puissance considérable sous des dehors cordiaux. Elle peut faire beaucoup de mal. Elle peut aider aussi aisément à lancer un inconnu.
Le dîner se poursuit. Chère excellente, bons vins, bon champagne, servis par des valets dignes du faubourg Saint-Germain.
On tâche de parler de tout sauf de cinéma, et, parce qu'il y a des Français, chacun donne son impression sur Paris.
— J'aime beaucoup Paris, me dit avec son accent délicieux Mae Mac Avoy. Mais les taxis vont trop vite.
L'ambassadeur et le banquier semblent un peu déçus. Ce dîner est semblable à ceux qu'ils donnent dans leurs hôtels de New-York. Et ils vont être obligés d'inventer quand ils raconteront leur soirée chez G.S… C'est trop banal, aussi.
Au salon, le café et les liqueurs sont servis. G… fait les honneurs d'une façon exquise. Des groupes s'organisent. Le comte est entouré de huit femmes et il a l'air ravi. Louella Parson lui promet d'écrire un article sur lui. Elle sait déjà par cœur les titres des chefs-d'œuvre qu'il n'a jamais écrits. Le champion de ping-pong est presque délaissé.
On danse très peu à Beverly Hlls, après dîner. Les gens qui ont travaillé toute la journée aiment encore à faire travailler leur cerveau. Des jeux s'organisent où le talent doit s'exercer et où l'improvisation joue un grand rôle. Rien n'est plus étonnant que de voir Marion Davies dans ses imitations de Lilian Gish, de Pola Negri, de Gloria Swanson. Gentiment, sans se faire prier, elle amuse la galerie pendant des heures. Quelquefois, Harry Crocker ou Chaplin ou Fairbanks Jr jouent avec elle de petites charades qu'ils imaginent. Cette personne est l'âme de toutes les belles parties et son esprit est étonnant.
Elle peut ainsi ravir son audience fort longtemps sans lasser personne. Mais vers une heure, tranquillement, elle rentre se coucher pour être sur le set à neuf heures du matin.
Chaplin, lorsqu'il connaît bien les gens chez qui il est, et ceux qui sont invités, est remarquable aussi. Il chate. Il joue du piano, il imite, il s'amuse, il raconte des histoires avec une telle verve que, comme des enfants, nous ouvrons grands yeux. Est-il possible qu'en improvisant on puisse avoir tant d'idées ?
Il a conscience de sa supériorité. Sa petite taille se redresse. Et sous ses cheveux gris coule le fleuve bleu du génie.
Mais la grande distraction d'après dîner est le bridge. Tout le monde, à Beverly Hills, joue au bridge. Les tables sont mises dans le salon, dans le fumoir, et les Barthelmess, les Fitzmaurice, les Swanson, les Goldwynm les Bébé Daniels, les Eddie Kane, s'installent. Tous jouent très bien. Mme Fitzmaurice et Bébé Daniels sont, paraît-il, des joueuses très remarquables. Et à mesure que les tables se forment, le silence grandit.
— One no trumps.
— Two spades.
Les fronts de ces jolies femmes, que le monde entier admire, se plissent sur les cartes neuves. Comme elles sont bourgeoises, ces artistes ! Comme elle aiment l'effort, l'effort perpétuel ! Comme leurs jeunes visages si beaux, à peine maquillés, semblent sérieux et préoccupés ! Rien n'est plus délicieux que de sentir chez ces femmes qui ont travaillé depuis leur enfance un tel dédain de la puérilité. On devine qu'elles aiment l'ordre et l'organisation, elles aiment être sérieuses.
Le comte ne joue pas au bridge, moi non plus. Nous somme affalés sur un divan; à côté de jeunes personnes fort jolies nous tiennent compagnie. Elles parlent doucement de leurs prochains rôles.
Chose curieuse : dès minuit, les parties s'interrompent. Les traits se marquent. Les yeux se ferment un peu. Une atmosphère de fatigue se dégage de ces corps qui font dans la journée des efforts perpétuels. A une heure du matin, il ne reste que deux tables de bridge. Le salon est éteint.
L'ambassadrice et la femme du banquier, qui ne savent pas jouer aux cartes, ont, pour passer le temps, bu. Elles se précipitent sur nous :
— Mettez le phono. Nous allons danser.
C'est l'heure où l'on doit commencer à rire; j'empoigne la femme du banquier, et c'est avec cette digne bourgeoise que, sous l'œil légèrement dédaigneux et désapprobateur de G…, je me suis lancé dans le tourbillon gai qui s'est fait tant attendre.
Voilà quelles sont les orgies. Et toutes les «parties» à Beverly Hill ressemblent à celle-là. De temps à autre, lorsqu'il y a beaucoup de travail, ou dans quelque maison moins importante, le bridge dure jusqu'à cinq heures du matin et on se couche plus tard.
Mais les Fairbanks, les Swanson, les Corinne Griffith, les Marion Davies, sont des êtres humains très sages. Leurs réunions, un peu conventionnelles, sont dues à ce qu'ils ont trop vécu, trop lutté depuis leur enfance pour avoir la situation qu'ils ont, pour se complaire à des sauteries d'ivrognes. Ils se trouvent dans la position des gros industriels qui ont peur de faire la noce à Montmartre avec de petites femmes, de peur qu'un de leurs secrétaires ne les voie… Ils ont trop de soucis, trop de responsabilités, trop de choses à régler, pour se permettre de faire les fous, – du moins, en public.
Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la prudence. Les rois sont obligés de faire ce que l'étiquette leur prescrit de faire. Ils sont un peu dans le même cas. Et leur publicité ? Ne doivent-ils pas s'en méfier ? Les journalistes savent tout; leur indiscrétion ne connaît pas de limite. Un petit doigt levé de travers leur fournit trois colonnes dans leur papier du lendemain; eux sont trop à l'affût de scandales, les maîtres chanteurs d'argent à gagner, d'accusation trop faciles, et le public de changement, pour que les stars risquent de les satisfaire ainsi tous.
Imaginez que Fairbanks, un peu plus gai que de coutume, renverse, avec sa voiture, un bec de gaz, Sunset Boulevard. Quelle affaire pour le policeman qui lui dressera sa contravention, pour le magistrat qui le jugera ! N'auront-ils pas tous deux leurs noms dans les journaux ? et une énorme manchette, le lendemain, traduira :
«Terrible accident d'auto. Doug ivre mort après orgie.»
Et puis, ne sont-ils pas presque tous mariés ? Qui sait si tout cela se passerait de la sorte si tout le monde était célibataire à Hollywood ? Alors, ces soirées de réputations si diverses ne sont, en somme, que des soirées charmantes dont les hôtes importants et tranquille ne veulent, par d'inutiles performances nocturnes, nuire ni physiquement ni moralement à leur accablante popularité et à leurs travaux.
Sans faire une plaidoirie, sans vouloir dire que tout est parfait, je ne suis pas mécontent, moi qui ai vécu dans ce milieu fort longtemps, de dire la vérité sur ces «wild parties» dont j'ai seulement entendu parler, mais auxquelles je n'ai jamais assisté chez les «stars» de Beverly Hills.
René Guetta
(A suivre.)
[1] Copyright by René Guetta, 1929. Tous droits réservés.
[2] Mr Liggett a dans tous les Etats-Unis une chaîne pharmacies (drug-stores) qui non seulement vendent des médicaments, mais aussi des ustensiles de toilette, des ice cream sodas, des bretelles, des parfums, etc…
[3] Appareil de prise de vue.
René Guetta
Cinémonde, 28 mars 1929.
Sonore ou parlant ?
Hollywood, patrie du cinéma, Hollywood, terre promise pour beaucoup de ces jeunes imprudents qui veulent «faire du cinéma», Hollywood, pays de rêve, Olympe des dieux de l'écran ! M. René Guetta, qui le connaît bien pour y avoir été successivement acteur, assistant et secrétaire de grandes stars – il vécut pendant trois mois dans l'intimité de Gloria Swanson et de son mari – nous en rapporte un beau livre, plein de détails pittoresques, et qui contient d'intéressantes révélations tout en ruinant bien des légendes trop faciles : Sous le Ciel de Hollywood, Trop près des Etoiles (Plon, Editeur). Nous avons voulu, pour nos lecteurs, extraire quelques pages de cet excellent livre, qui leur donneront une idée de ce qu'est le film parlant pour les Américains, et quelle confiance ils ont en lui.
— J'ai dit qu'avec les moyens techniques actuels, il était difficile de faire vraiment de «l'art» au cinéma. Les Américains commencent à s'en apercevoir et ils décidèrent de faire un grand effort en perfectionnant les projections en couleurs et en propageant le film parlant. Bien des techniciens me répondront qu'ils n'ont pas, jusqu'à présent, fait grand-chose pour l'art cinématographique. Je ne suis pas de cet avis. Les Américains ont chaque année plusieurs films qui leur coûtent en général plus qu'ils ne leur rapportent et tournés dans le seul espoir d'aller de l'avant. Ils n'hésitent pas, même, à payer très cher des Allemands comme Murnau et Lubitsch qui, par leur grand talent et leurs magnifiques réalisations, apportent des idées nouvelles, pour pouvoir étudier et pour être capables de transmettre à leurs compatriotes ce qu'ils viennent d'apprécier. En France, nous faisons le contraire; nous nous ancrons dans nos erreurs en n'admettant pas qu'elles soient des erreurs; en refusant, par orgueil, d'écouter ou d'étudier d'autres méthodes. Nous conservons dans leurs coquilles les mêmes metteurs en scène qui font toujours les mêmes fautes, les mêmes artistes, les mêmes assistants.
Nous ne nous offrons pas le luxe d'apprendre de l'Etranger pour pouvoir ensuite nous apprendre à nous-mêmes. Et pourtant, si l'on en juge par le résultat !
Revenons aux films parlants. Tout de suite l'opinion française fut contre. Avant de voir, on a jugé, ce qui est toujours un tort. Or, il y a un fait très net : c'est que des hommes comme Winnie Sheehan de chez Fox, comme All Rocket de chez F.N., comme Warner Brothers, comme J.-P. Kennedy, les uns et les autres qualifiés par une longue expérience, qui sont les artisans du développement du cinéma américain, ne sont pas intéressés par l'idée, mais enthousiasmés. A tel point que l'année prochaine, il y aura mille théâtres munis d'appareils parlants, et que Fox a déjà dépensé deux millions de dollars à la recherche de perfectionnements. L'idée a été lancée et adoptée avec une rapidité fantastique.
Des spécialistes de théâtre furent mandés, les meilleures voix furent enregistrées, des professeurs de diction furent accaparés. Tous les artistes ayant une expérience de la scène furent recherchés. Toute une organisation nouvelle se forma indépendamment de l'ancienne.
Paramount, même, ouvrit des studios clos depuis deux ans (Astoria, près de New-York, sous la direction de Walter Wenger, l'ancien directeur de Hollywood). Le résultat les a récompensés. Leur premier film vient de sortir. C'est un succès.
Quelles sont les raisons de cette réussite si soudaine, si inattendue ? D'abord, le film silencieux a toujours eu besoin de sons. Vous êtes-vous rendu compte de l'ennui d'un film sans musique ? Vous n'iriez pas deux semaines de suite dans un cinéma dont l'orchestre, l'orgue ou le violon, n'accompagneraient pas de sons tristes la tristesse du héros, de sons gais sa gaieté. Et les bruits de coulisse ? les bruits de vagues ? les bruits de canon ? les bruits de cavalcade ?
Ne croyez-vous pas que l'émotion provoquée en regardant le film La Grande Parade, par exemple, fut décuplée en entendant le son du canon, faiblement rendu cependant par une quelconque grosse caisse ?
Maintenant, tous ces bruits seront réels : on verra la mer, on entendra son chant. On verra défiler des soldats, on entendra leur pas. On verra des autos, on entendra le moteur; on verra un mariage, on entendra l'orgue et les chœurs. Tous les bruits généraux seront enregistrés et, au lieu d'être exécutés par des étrangers des films, seront réglés par ceux qui les créent. C'est la ruine des bruits de coulisses, si grotesques souvent. C'est presque la ruine des orchestres. Mais quelle unité de sensations quand, à Saïgon, par exemple un film tourné à Los Angeles pourra impressionner l'audience avec des vibrations captées par les mêmes cerveaux créateurs; cela ne remplacera-t-il pas avantageusement, par leur unité, la vue d'une tempête formidable, accompagnée d'un grêle piano mécanique ?
Enfin, le film parlant ouvre le champ très limité du film silencieux.
Il fallait quelque chose de nouveau qui intéressât la foule un peu blasée de la monotonie des pellicules. Le film silencieux était coincé. L'art et la fantaisie étaient limités par la manière même dont on projetait le drame. Les films silencieux n'atteignaient que l'un de nos sens : la vue. Bien des effets se trouvaient, par conséquent, diminués d'intensité; bien des choses inexplicables alors pourront être développées quand il sera possible d'impressionner deux sens au lieu d'un. Et la délicatesse du nouveau procédé qui commence à être mis au point sera, justement, l'art de n'impressionner qu'au bon moment, par un effet choisi avec soin. Combien, dans ces conditions, le sentiment de la peur, entre autres, incomplet jusqu'à présent au cinéma, pourra être développé ! La nuit, un coup de revolver ! Un Cri ! Cette banalité fatigante jusqu'à présent peut devenir maintenant tellement angoissante ! De même, certaines phrases dites au moment propice. Un mot d'amour, d'homme à femme, de mère à enfant. Un hurlement de désespoir, un murmure de résignation murmuré par un gosse en pleurs.
Télécharger des textes de René Guetta (55 p.).