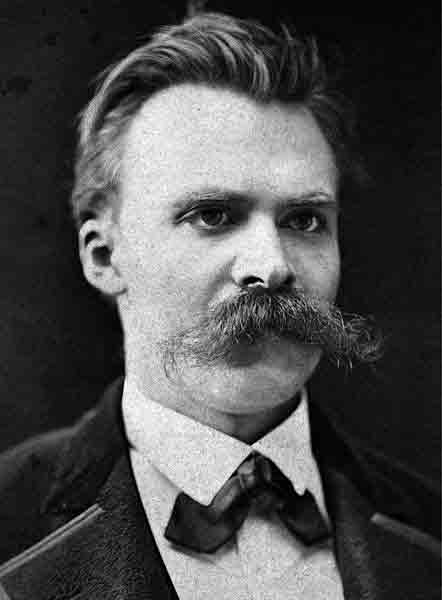E/1971.07 — André Malraux : «Jean Vilar : un entretien avec André Malraux», Magazine littéraire [Paris], n° 54, juillet-août 1971, p. 10-24.
André Malraux
Jean Vilar : un entretien avec André Malraux
Extrait 1
Il ne faut pas se raconter d'histoire : aucun d'entre nous à cette époque ne pensait à Mao qui n'avait manifesté d'aucune manière une volonté de diriger la révolution chinoise. Mao est intervenu à peu près dix-huit mois plus tard, mais à cette époque, il n'était qu'un membre fort modeste du comité central.
Vilar — L'avez-vous rencontré à ce moment-là ?
Malraux — Je l'ai rencontré, mais il ne comptait pas. Il avait été bibliothécaire de la grande Bibliothèque de Pékin, et se trouvait alors bibliothécaire au Comité Central et assurait le travail du comité. Il était bibliothécaire au sens le plus technique du mot, c'était l'homme qu'on charge des recherches. Il semblait très satisfait de son sort, mais il n'était pas en cause.
Ce qui était en cause, le grand conflit, se jouait entre Chang Kai-chek, qui représentait à sa manière l'héritage, et Moscou. Avec des personnages latéraux. Quand on pose la question du trotskysme dans la révolution chinoise, on parle pour ne rien dire. Les staliniens estimaient que la révolution viendrait du prolétariat et cela ne pouvait pas être autre chose. Mais les trotskystes prêchaient la même chose.
Il ne faut pas qu'on nous dise que les uns ou les autres soutenaient la paysannerie. Ils étaient tout à fait opposés à l'idée d'une révolution paysanne. Le seul qui ait cru en cette révolution paysanne, c'était Mao, mais il n'y a cru que plus tard. Il raconte lui-même qu'il comprit que ce serait les paysans qui feraient la révolution chinoise seulement quand, chassé par la défaite de Shanghai, il revient dans son village et vit que, à cause de la famine, l'écorce des arbres avait été rongée par les paysans jusqu'à quatre mètres du sol. C'est là qu'il a dit : c'est avec les hommes qui mangent l'écorce que l'on fera la révolution et pas avec les chauffeurs de taxi qui gagnent quinze fois ce que gagne un pousse.
Il ne faut pas s'y tromper, tous les révolutionnaires russes, qu'ils soient trotskystes ou staliniens, partaient du prolétariat. Mao seul est parti de la paysannerie révolutionnaire.
Extrait 2
Vilar — L'un des épisodes les plus célèbres de La Condition humaine est celui où Katow, sur le point d'être brûlé vif dans une chaudière, donne son cyanure à un de ses camarades. Est-ce que l'épisode est authentique.
Malraux — La locomotive oui, il y a énormément de documents là-dessus, même dans les journaux de l'époque qui étaient tous entre les mains de Chang Kai-chek vainqueur, et dont le ton était à peu près : il faut tout de même en finir avec ces ordures.
Pour le cyanure, c'est autre chose. Je n'y avais absolument pas pensé et j'écrivais cette scène comme elle s'était passée dans la réalité, les types qu'on jette dans le foyer de la locomotive : ce qui était quand même impressionnant quand on pense à Katow qui n'étant pas chinois, est entré dans ce jeu et sait qu'il va être brûlé. Avec ou sans cyanure, ce n'est quand même pas rien.
C'est en écrivant le passage sur ses mains que ma scène a pris un virage perpendiculaire et que j'ai pensé : il faut qu'il lui donne le cyanure. Episode complètement imprévisible et qui ne pouvait rien avoir de véritablement historique. Même s'il avait véritablement eu lieu, il ne serait qu'épisodique. Je ne suis pas parti d'une réalité, ni d'une sorte de mythe. C'était l'espèce d'instinct, tout à coup le : c'est mieux comme ça.
Ce qui m'a frappé, c'était l'idée d'un gros plan avec les deux mains et Katow qui dépose le cyanure dans la main de l'autre; ç'aurait été un plan superbe.
Vilar — Il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi le théâtre.
Malraux — Ah ! mais le théâtre n'a pas de bonnes mains.
Vilar — Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où il était question d'adapter La Condition humaine au théâtre, vous m'avez demandé : «Est-ce que vous adaptez tout le roman ? Ne vaudrait-il pas mieux adapter uniquement l'épisode du cyanure ?»
Malraux — Cela prouve que j'avais grande confiance en vous, j'avais bien raison mais tout de même, il y a un problème : le théâtre est toujours un peu désarmé devant les petits objets, et il faut s'arranger avec les mots. Si vous faites un film, il n'y a pas de question, les mains devant l'écran et le cyanure est aussi visible qu'un petit garçon à côté de deux grandes personnes. Au théâtre, non.
Vilar — Je ne veux pas faire une querelle cinéma-théâtre, mais je dois vous dire qu'au théâtre, l'accessoire n'a absolument aucune importance.
Malraux — Vous parlez tout à fait comme Meyerhold, donc fort bien. Je lui avais posé la même question au moment où il faisait son scénario en même temps que Eisenstein faisait le sien. Et Meyerhold m'avait répondu : «Le cinéma, ça m'est complètement égal. Je ne peux rien faire comme les gens de cinéma, mais je peux toujours en faire autant pourvu que je ne me mette pas à les imiter. Il faut que je m'y prenne autrement. Eh bien, je m'y prendrai autrement. C'est leur métier et c'est le mien». Et il n'était pas du tout inquiet. Il avait en face de lui le plus grand metteur en scène de cinéma du monde, Eisenstein, et il n'était pas inquiet du tout.
Vilar — Meyerhold a commencé l'adaptation, a répété…
Malraux — Beaucoup plus que commencé. Je crois qu'il avait écrit presque tout et…
Vilar — Il suivait le roman ?
Malraux — Non. Il faisait un montage. Il avait un procédé qui l'enchantait, et je ne sais pas ce que cela aurait donné pour les scènes de combats révolutionnaires. Il avait des écriteaux sur lesquels étaient inscrits quatre ou cinq mots essentiels sur, disons, l'histoire du prolétariat. Ces écriteaux étaient à l'envers sur le plateau, et, le moment venu, on les relevait et l'inscription était puissamment éclairée. En même temps, le reste de la scène s'éteignait.
Vilar — Vous avez suivi ces répétitions ?
Malraux — Non. C'est lui qui m'a raconté ça quand je l'ai rencontré en URSS en 1934. Ça doit être en 34, au moment du Congrès des Ecrivains. J'avais dû rencontrer Trotsky au début de l'année à Royan, et le Congrès doit se placer vers septembre-octobre.
Vilar — Pour quelle raison n'avons-nous plus entendu parler de ce travail que faisait Meyerhold sur La Condition humaine?
Malraux — La purge qui avait commencé. Meyerhold a commencé par être à moitié hors-la-loi, puis a été arrêté, et on lui a dit : mon ami, vous travaillerez quand on vous le dira. Et il n'a pas travaillé sinon, après le rapprochement avec les Allemands, sa mise en scène théâtrale de Wagner.
Vilar — Vous avez beaucoup travaillé avec Eisenstein.
Malraux — Enormément. Tout le scénario de La Condition humaine a été fait en commun. En commun, c'est évidemment une façon de parler : je n'allais pas expliquer à un homme de son génie comment il allait faire son film.
Ç'aurait été un de ses plus grands films. Vous ai-je raconté comment il voyait la dernière séquence ? Vous vous souvenez : des prisonniers qui vont être jetés vivants dans une locomotive qui a un foyer énorme, puisqu'elle est chauffée au bois; on les appelle l'un après l'autre et ils se dirigent vers la locomotive. Et Katow se dirige à son tour vers la locomotive. Or, il est blessé et boîte. Il y avait un plan où Katow qui boîte de sa jambe droite plus courte, s'inclinait vers la droite, le plan suivant montrait l'une des armées révolutionnaires marchant vers Shanghai sur la droite, Katow fait le pas suivant, et par conséquent se redresse, puis l'autre armée révolutionnaire monte vers Shanghai sur la gauche. Toute la séquence était comme ça, un pas de Katow, une armée, un autre pas l'autre armée, et Eisenstein au montage, accélérait le mouvement jusqu'au moment où l'on voyait non pas jeter Katow dans la locomotive, mais seulement le prendre : puis le grand coup de sifflet signifiant que la locomotive avait reçu sa proie, et en même temps que ce sifflet les deux armées se rejoignaient et entraient dans Shanghai. C'était la dernière séquence.
Vilar — Au fond, si le personnage de Katow était si proche de vous, c'est parce qu'il est l'homme de la fraternité.
Malraux — Je ne sais pas. On ne sait jamais pourquoi un personnage est proche de soi ou non. C'est imprévisible, peut-être pour des raisons très lointaines, peut-être parce que Katow est un personnage très peu gouverné.
Mais je reviens à Eisenstein. Il avait à peu près fait les deux-tiers du synopsis quand il a vu venir le drame. Ce qui a déclenché les purges, c'est l'assassinat de Kirov, mais Eisenstein les pressentait, et il m'avait dit : nous ne tournerons pas le film, je ne m'en sortirai pas.
Alors, je lui avais dit : «Pourquoi ne vas-tu pas voir Staline, ça vaudrait beaucoup mieux. Que peut-il arriver ? Au pire que la situation soit ce que tu crains. Eh bien, puisque c'est ce que tu crains pourquoi ne pas le faire ?» Alors, il m'a dit : «Je n'irai pas parce que je crois qu'il n'aime pas ce que je fais. Et s'il ne tient pas compte de ce que je lui dis, il faudra alors que je me tue». Et je crois qu'à la fin, il s'est à peu près tué.
Vilar — Il s'est tué ?
Malraux — On le dit. En tout cas, il est mort dans des conditions tout à fait singulières. Il avait reconquis sa gloire mais les films qu'il faisait, Staline ne les aimait pas. Staline aimait une sorte de socialisme réaliste, épique avec des partisans, des chevaux. Il n'aimait pas le côté géométrique et Greco du Potemkine.
Vilar — En 1934 vous avez connu Staline. Comment était-il ?
Malraux — Le contraire de ce qu'on dit. Il avait l'air d'un adjudant de gendarmerie bienveillant. On a beaucoup dit, notamment Soljenitsyne, qu'il était petit. Il est fort possible qu'il ait perdu de sa taille. Le général de Gaulle avait certainement perdu entre 10 et 15 centimètres. Mais le Staline que j'ai connu avait ma taille, 1,79 m, il n'était pas petit. C'est après qu'il a changé. De même que ce qu'on a appelé sa moustache de chat perdu date de la fin.
Quand je l'ai connu, il était grand, il était costaud. C'était avant les purges, mais il avait quand même déjà fait beaucoup de choses, mais personne ne le considérait comme un personnage tragique. Il avait cet air très bienveillant, à mille lieux du fantôme tragique et shakespearien dont on nous a parlé.
Vilar — C'était un masque ou une évolution ?
Malraux — A mon avis, une évolution. Il est possible que le portrait de Soljenitsyne soit complètement littéraire, et qu'il n'ait jamais vu Staline. Mais j'ai lu, comme tout le monde, le portrait de Staline par Djilas; Djilas l'avait vraiment connu et son portrait, selon toute vraisemblance, est exact. Or si je le compare avec les souvenirs, nos deux Staline sont complètement différents.
En 1934, il était déjà entouré d'une sorte de terreur. Je me souviens d'un repas de cent couverts chez Gorki et la rumeur d'un repas de cette taille. Puis un silence soudain : c'est les bottes de Staline qui arrivaient. Mais sa cordialité apparente n'était pas douteuse.
Quand nous parlons de ces choses, mettons bien les dates. Mes souvenirs de Staline se placent six ans avant la guerre. Djilas l'a connu à peu près vingt après moi. Pensez, si quelqu'un avait connu Napoléon vingt ans avant 1815; c'aurait été l'extrême début de la campagne d'Italie.
Vilar — Mais on avait déjà peur de lui. Eisenstein avait peur de lui.
Malraux — Peur, mais pas comme on se l'imagine. Au début, il n'avait pas peur d'être envoyé en prison. Il avait peur d'être empêché de travailler, il craignait une interdiction, une censure; mais pas quelque chose de physique comme une arrestation.
Vilar — Puisque vous venez de parler de Meyerhold et d'Eisenstein, comment expliquez-vous cet extraordinaire foisonnement de créateurs entre les années 22 et 34 en URSS, qui font de ce pays l'un des plus extraordinaires pour la création cinématographique, théâtrale et poétique, et puis d'un coup, cette sorte d'arrêt. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de créateurs par la suite et qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle, en URSS, mais il n'y en a plus eu de cette taille, de cette audace.
Malraux — Par deux raisons sans doute mauvaises toutes les deux. D'abord, l'histoire des taches du soleil, qui n'apparaîtraient qu'à certaines époques. Il y a des moments précis où le génie foisonne : le romantisme, la peinture avec des gens nés entre 1830 et 1840. Ça a eu lieu en Russie, c'est sûr.
La seconde raison est moins irrationnelle, ces gens sont liés les uns aux autres. Meyerhold disait : «Je n'ai eu que deux disciples qui comptent : Poudovkine et Eisenstein».
Quand on est le plus grand metteur en scène du monde, avoir pour disciple un très grand metteur en scène et le plus grand metteur en scène du monde, c'est tout de même étonnant, même si c'est relativement légitime. C'est l'histoire des grands héritages.
J'ai dit tout à l'heure que Trotsky donnait l'impression du génie. Meyerhold donnait l'impression d'un génie parfaitement évident. Il avait inventé au théâtre un certain nombre de choses simples. Quand il a monté Le Revizor, dans la scène à deux personnages, il utilisait le plateau tout entier et dans Le bal chez le gouverneur, où il y avait soixante personnages, il avait installé un petit tremplin carré où les personnages valsaient à se toucher les épaules. Moins il y a de personnages plus il faut d'espace, plus il y a de personnages, moins il faut d'espace.
Pensez à ce que cela pouvait représenter à côté du réalisme quelconque que rêvait Staline.
Ce foisonnement artistique à quoi vous faites allusion en Russie, c'est quelque chose d'équivalent à ce qu'a été pour nous le cubisme, une rupture totale.
Extrait 3
Vilar — Vous avez parlé des révolutions du XIXe siècle et de celles du XXe siècle. La guerre d'Espagne était-elle une révolution du XIXe siècle ou du XXe ?
Malraux — Entre les deux. Il y avait des chars et une aviation qui ont joué un grand rôle. Par conséquent, elle n'appartient pas aux révolutions du XIXe siècle, qui se sont terminées avec la révolution d'Octobre. Elle ne ressemble pas non plus à ce qui a suivi la guerre de 40. C'était une sorte de banc d'essai.
Vilar — Banc d'essai des révolutions ou des guerres ?
Malraux — La révolution espagnole et la guerre d'Espagne, ce n'est pas tout à fait la même chose. La révolution a eu lieu dans un laps de temps relativement court et, au fond, dans les conditions du XIXe siècle. C'est la guerre d'Espagne qui commence à se passer dans les conditions du XXe siècle : la différence, c'est qu'il y a des chars et des avions. Mais il ne faut pas raconter d'histoire, les avions russes ne sont arrivés que deux ans et demi après la révolution. Jusque-là, il n'y en avait pas un et les seuls avions qui ont permis d'arrêter dans une certaine mesure l'avance fasciste, étaient des avions français, et Dieu sait qu'ils n'étaient pas… très frais.
Extrait 4
Il faudrait parvenir à un système de garantie qui ferait que, par exemple, un grand metteur en scène de théâtre ou de cinéma, qui aurait réalisé mettons six œuvres importantes, obtienne son avance sans discussions; l'Etat conserverait ses droits pour une censure à supposer que… lorsque l'œuvre existe.
Ce qui est dément, c'est d'établir une censure sur une œuvre qui n'existe pas encore. Si l'on devait faire la même chose avec les romans, ce serait une démence incroyable. Prenons tous les grands romans, et transformons-les en un synopsis de deux pages. Le cycle de Vautrin, par exemple. On verrait tout de suite que Vautrin est homosexuel, et qu'est-ce que c'est que ses rapports avec Rastignac, que c'est un voleur à la tire, et qu'il va devenir peut-être chef de la police.
Vilar — Et c'est un bagnard.
Malraux — Recalé Balzac ! Recalé ! Zéro ! Recommencez-moi ça. Pour rester dans l'humour : un de mes frères, qui a été tué pendant la Résistance, me disait quand il avait dix ans : «Moi, ce que je voudrais, c'est être de l'Académie française». J'ai trouvé que c'était une drôle d'idée et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit : «Eh bien, parce que ce serait quand même bien intéressant» — «Ah oui, qu'est-ce qui t'intéresserait ?» — «Eh bien voilà, il y aurait M. Racine, M. Corneille, M. Victor Hugo, M. Lamartine, et puis il y aurait moi. Et alors moi, je leur dirai : “Recommencez-moi ça”». Quand je suis revenu au gouvernement, La Religieuse, qui avait été interdite, a été projeté, et de nouveau il n'y avait pas de quoi fouetter un chat.
Ce que j'ai vu d'Arrabal est vraiment l'équivalent de ce qu'à été jadis Pirandello. Tandis que La Religieuse, ça n'est pas Pirandello. On a fait sur ce film des articles très véhéments avec des tas de points d'exclamation, mais c'est un film anodin. Parlons cinéma, donc images. Quels sont les plans agressifs dans La Religieuse ? Même dans les histoires d'homosexualité, elles sont uniquement allusives. On s'embrasse, c'est absolument tout, alors que malgré tout dans le film de Malle, il y a quand même des lits, et ce ne sont pas les premiers.
Extrait 5
Vilar — Quelle a été l'importance, pour vous, de certains de vos contemporains qui étaient vos aînés ? Claudel, par exemple ?
Malraux — Très importante, très grande. J'aimais l'ampleur de Claudel et je me souviens qu'à la Nouvelle revue française, par laquelle nous sommes tous passés, je mettais très haut deux écrivains, à l'indignation générale : Claudel, et c'était avant Le soulier de satin, et Victor Hugo. Je revois Gide me disant : «Comment pouvez-vous aimer la Tristesse d'Olympio! C'est certainement pour des raisons sentimentales». Il était persuadé que j'avais lu la Tristesse d'Olympiojadis, à un moment où j'étais amoureux.
Vilar — Vous avez bien connu Claudel ?
Malraux — Non. On ne connaissait pas bien Claudel. Ce n'était pas dans sa nature. Il ressemblait aux propos qu'il a tenus à la radio, un homme qui mêlait une pénétration admirable à des enfantillages étonnants. Il parlait de Jacques Rivière et il disait : «Rivière devrait porter un scapulaire, c'est de cela qu'il a besoin et pas d'autre chose». Et vous vous disiez : c'est quand même assez pénétrant. Et puis il ajoutait : Vous qui avez fait du chinois, vous devriez comprendre que le français est une langue idéographique. Par exemple, le mot toit, t.o.i.t., avec la barre des t» Alors, là, on se disait que ça n'allait pas mieux. Mais Victor Hugo était tout à fait mal vu.
Vilar — Pourquoi ?
Malraux — Le romantisme, l'anti-mallarmisme.
Vilar — Est-ce que la pensée de Claudel vous a beaucoup frappé ?
Malraux — Bien sûr, elle me paraît importante, mais on ne peut pas dire qu'elle m'ait beaucoup frappé. Dans le domaine chrétien, celui que je place avant tout c'est Pascal, puis saint Augustin et Claudel. J'ai ressenti la volonté de prédication dans un texte comme l'Annonce faite à Marie, mais j'ai eu l'impression de quelque chose d'un peu exotique, hors de notre temps, tandis que Pascal me parlait.
Si les pièces de Claudel, quand elles ont été créées, échappaient au public, c'est aussi à cause d'un certain état de la sensibilité. Ce n'est pas exclusivement par réaction d'ordre social que les gens aimaient Henry Bataille. Claudel passait pour un hurluberlu, comme d'ailleurs Jarry.
Vilar — La révolution théâtrale, qui ne va pas du tout dans le sens de Claudel, commence avec Antoine et date de 1890.
Malraux — Il y a aussi Le Vieux Colombier. Avant lui, le théâtre, c'était de l'accident. On allait au théâtre comme on serait allé je ne sais où et c'est à partir du Vieux colombier seulement que le fusil s'est mis à tirer dans la cible.
Et Le vieux colombier va de pair avec La nouvelle revue française. Il a commencé à se former un petit groupe invulnérable qui s'opposait à tout le reste. Le Vieux Colombier se foutait d'Henry Bataille qui à ce moment-là, faisait des succès pendant trois ans. De la même façon, la N.R.F. se fichait complètement d'Anatole France. Pensez que quand j'avais vingt ans, c'était Victor Hugo, l'enterrement d'Anatole France. Pour la N.R.F., cela n'existait pas. Anatole France n'avait aucun talent. Elle défendait ses propres valeurs, celles-là et pas d'autres.
Le fait social joue, mais il y a eu alors un autre fait social qui a joué en littérature, une évolution de la sensibilité qui a eu un effet important. Quand il s'agit de théâtre, Jean Vilar a raison, chaque représentation coûte une certaine somme. Mais quand il s'agit de livres, c'était autre chose. Le prix n'était pas en cause. Il y a eu un moment où les livres sont devenus des livres contre la maison Calmann-Lévy, c'est-à-dire contre France, Loti et Barrès. Mais Barrès est resté.
Vilar — Pascal, Claudel. Vous n'allez tout de même pas dire que la pensée chrétienne de Claudel a eu une influence sur vous ? Je vous pose cette question parce que dans Les Chênes qu'on abat, vous dites que le général de Gaulle pense que vous êtes, à votre façon, un chrétien.
Malraux — C'est une boutade dans les deux cas; quand il pense que je suis un chrétien et quand je pense qu'il ne l'est pas. Parce que la vérité, c'est qu'il était tout de même profondément chrétien.
Vilar — Vous êtes resté disons agnostique, incroyant.
Malraux — Absolument, et le Général était troublé par mon agnosticisme parce qu'il avait l'habitude d'agnostiques ennemis de la religion, ce que je n'ai jamais été.
Je ne suis pas anticlérical, je ne suis pas surréaliste pour un sou. Ce problème ne m'intéresse pas et je ne suis pas anti-religieux, étant donné que mon agnosticisme reposerait plutôt sur une connaissance relativement sérieuse de plusieurs religions. Quelque chose intriguait beaucoup le général de Gaulle : ceci : «comme c'est drôle que cet homme qui est agnostique, soit le seul de mes commensaux à pouvoir discuter à égalité sur saint Augustin avec Thierry d'Argenlieu», qui était supérieur des Carmes. Il pensait que si l'on n'était pas croyant, on était contre, et que je ne sois ni l'un ni l'autre l'étonnait.
Vilar — Quelques années avant vous, il y a eu un grand écrivain qui avait cette position; il était incroyant, et il comprenait le sentiment religieux : c'est Barrès. A-t-il eu de l'influence sur vous ?
Malraux — Oui et non. Comme tous les gens de ma génération, j'ai été très frappé par le Barrès du début. Nous ne lisions pas les articles de l'Echo de Paris, ni ses chroniques sur la grande guerre. Ce que nous avions lu et que nous lisions, c'était Du sang, de la volupté et de la mort, et mettons Les Déracinés.
Mais très vite, dès que j'ai connu l'Asie, j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait dans Barrès, que c'était un très grand artiste doublé d'un esprit moyen, qui reposait sur un malentendu fondamental. Il disait «Je suis le défenseur des valeurs de l'Occident contre l'Allemagne, qui est un pays tout à fait différent». Vous voyez la suite, Massis et Cie. Pour moi, quand Barrès disait : A bas l'Allemagne, ce qu'il voulait dire c'était : concevons une Europe pour l'opposer à l'Asie. Si on l'avait poussé à bout, il aurait dit : l'Asie finit au Rhin.
Pour moi, l'Asie ce n'était pas du tout le Rhin. Pensez à notre réaction quand il a publié Enquête aux pays du Levant. Ce qu'il appelait l'Asie, c'était le Proche-Orient. Qu'est-ce que c'était que cette Asie où il n'y avait pas les Indes, pas la Chine, pas le Japon ? Ça vous aurait donné envie de lire Pierre Loti.
Extrait 6
Vilar — Vous venez de parler de Valéry. Or Valéry est un contempteur de l'Histoire, un redoutable analyste. Alors que vous, vous vous êtes nourri de l'Histoire vous êtes un de ses fidèles.
Malraux — Le mot Histoire est assez dangereux. Valéry attaquait énormément l'Histoire, ce qu'il appelait l'Histoire. Il n'empêche qu'au balcon de l'Europe, c'est le plus fort essayiste historique du siècle, à la seule exception de Spengler. Pour quelqu'un qui pense du mal de l'Histoire, ce n'est pas rien.
Je pense qu'il en va du mot Histoire comme de tous les mots capitaux : Dieu, amour, mort. Ce sont des mots à significations superposées. On finit par entendre par Histoire des choses complètement différentes. J'assistais, à l'Union pour la Vérité, à la grande discussion de Valéry contre des historiens et l'un d'eux trouvait abusif que des conscrits arrivent à l'armée et que, quand on leur demandait qui était Jeanne d'Arc, ils répondent : la femme de Napoléon. Et Valéry dit : «Après tout, pourquoi n'aurait-elle pas été la femme de Napoléon ? Je vois au moins deux raisons : d'une part qu'elle était vierge, d'autre part qu'elle n'était pas la femme de Napoléon». Ça n'était pas très sérieux comme discussion, mais ce qu'il voulait, c'est qu'on refuse d'accepter l'Histoire comme valeur. Vous vous souvenez de la phrase où il parle de cette conception de l'Histoire qui rend les nations insupportables et vaines. C'est de cela qu'il ne voulait pas entendre parler. Mais bien évidemment, il ne concevait pas ce qui s'était passé dans le monde comme une suite de purs hasards. Je serais plus enclin à dire que Valéry était l'ennemi des historiens plus que l'ennemi de l'Histoire parce que, qu'on le veuille ou non, il nous faut bien concevoir le monde comme Histoire. Pas forcément Histoire au sens que ce mot a au XIXe siècle, mais Histoire quand même. Nous touchons à un problème tout à fait essentiel : peut-on avoir une conception du monde absolument étrangère à tout sens ? Je serais assez prêt à dire que Valéry était un agnostique de l'Histoire. Qu'est-ce qu'un agnostique ? Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est quelqu'un qui dit : je voudrais savoir ce que veut dire le mot Dieu, puisqu'il recouvre quatre ou cinq choses différentes, puis je voudrais savoir ensuite comment les données fondamentales de l'être humain, de la vie et de la mort peuvent être pensées par l'intelligence humaine, en reprenant la comparaison fameuse du Coran modernisée aujourd'hui en Islam : la fourmi peut être écrasée par l'auto, mais elle ne peut pas inventer le moteur à explosion.
Au fond, la pensée de Valéry était à peu près celle-ci : je suis agnostique de l'Histoire : je ne crois pas à la mise en forme qu'on me propose, mais je ne crois pas non plus qu'on puisse remplacer cette mise en forme par rien du tout.
D'autre part, les obsédés de l'Histoire sont aussi des obsédés du temps et pour Valéry, le temps ne joue pas beaucoup. Mais il me semble très difficile cependant, pour une pensée moderne, d'ignorer le temps. Valéry était un très grand esprit, très supérieur à ce qu'on écrit sur lui, l'un des plus grands esprits que j'ai jamais rencontrés. Mais, pour bien des problèmes, il était dans une perpétuelle recherche. Il se levait à cinq heures du matin et commençait à écrire pour tirer au clair ce qu'il pensait, mais, à mon avis, il est mort sans avoir vraiment tiré au clair ce qu'il pensait de l'Histoire. Ce qu'il savait clairement, c'est qu'il ne voulait pas accepter les historiens, que les catégories des historiens ne lui paraissaient pas de réelles valeurs. Mais rien de plus.
Vilar — Il y a aussi Valéry poète.
Malraux — Pour moi, la poésie de Valéry comprend cinq cents vers sublimes, et le reste c'est de la poésie Empire comme il y a des pendules Empire. Il a ressuscité assez conventionnellement quelque chose qui lui était bien antérieur, un mélange d'éléments qui viennent de Malherbe, de Racine, de Chénier. Ça m'intéresse parce que c'est du talent, mais ça ne m'intéresse pas outre mesure. Valéry pour moi, c'est naturellement Narcisse.
Les poètes qui ont marqué ma jeunesse, comme tous les gens de ma génération, ce sont les symbolistes Mallarmé, un peu moins Verlaine, les poètes maudits, naturellement Rimbaud et puis après Claudel. Disons que le grand poète pour moi c'était Claudel, Victor Hugo c'est autre chose. C'était un poète colossal que je défendais d'autant plus que j'étais tout à fait surpris d'être dans un milieu littéraire où on en pensait tant de mal. Le «Victor Hugo hélas» de Gide a obnubilé La Nouvelle Revue française pendant longtemps. Regardez son anthologie de la poésie : je crois qu'il doit y avoir deux strophes d'Olympio.
Vilar — Qu'y a-t-il dans votre anthologie de Victor Hugo ?
Malraux — D'abord tout le côté malherbien, le début de Villequier : «Maintenant que Paris est ses pavés, et ses marbres, et tous ses monuments sont bien loin de mes yeux, je viens à toi, Seigneur, père auquel il faut croire, je t'apporte… des morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé». Et puis alors, la même chose dans Olympio: «Voici longtemps que celle avec qui j'ai dormi, Ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre et nous sommes encore tout liés l'un à l'autre et elle à demi vivante et moi mort à demi». Et puis je suis en train de m'apercevoir que ce n'est pas Olympio du tout, c'est cinquante ans plus tard. C'est Booz et ça aurait pu être Olympio. Le moment, n'est-ce pas, où il joue ce grand jeu de l'Océan, le flot qui avance et qui recule, avec cette tenue incomparable qui n'a pas d'équivalence en français. Il n'y a pas de doute. Plus naturellement le tombeau de Théophile Gautier qu'adorait Valéry : Valéry disait que c'était son plus beau poème, celui des chênes.