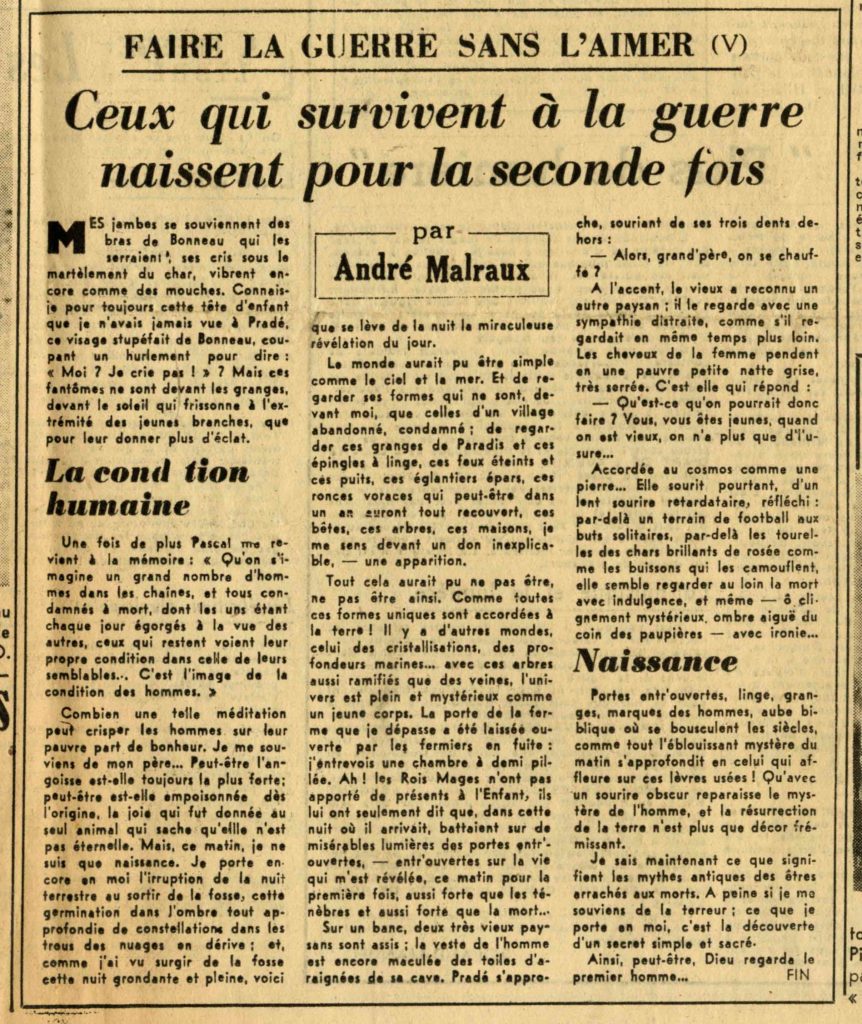«Faire la guerre sans l'aimer», par André Malraux
(III) On ne s'habitue pas à mourir
Pradé coupe l'allumage !
— Qu'est-ce que tu fous !
Malgré ma fureur de sortir, je sens le silence monter autour de nous comme une cuirasse : tant que nous n'entendrons rien siffler, pour quatre secondes, nous sommes vivants. Cette porte va-t-elle cesser de taper ? J'écoute avec la même démence que j'ai regardé jusque-là, et je n'entends sous le gond de la porte que le grondement de nos vagues de chars, répercuté par la fosse et par le blindage, qui passent et s'éloignent… Mon casque collé à celui de Pradé, je hurle : «Monte !» dans le trou de son couvre-oreilles, ma voix emplissant le char dans l'étrange silence revenu.
L'obus
Pradé, les jambes en l'air, calé par son siège dans le tank immobile et dressé, se tourne vers moi : comme la tête de Bonneau, sa tête de vieux, malgré le casque, est devenue innocente; ses yeux bridés, ses trois dents esquissent un sourire indulgent d'agonisant :
— L'fiston, à c'coup-ci, j'crois bien qu'il est foutu… V'là qu'elles recommencent à potiner, les chenilles…
Il parle presque bas. J'essaie d'entendre sous les mots l'imperceptible naissance d'un sifflement d'obus :
— Si on insiste, on va se foutre sur le ventre…
Le sifflement… Nous n'avons plus de cou. Les jambes de Pradé ont quitté les pédales avec un mouvement de grenouille, protégeant son ventre. L'obus éclate à trente mètres derrière nous.
— On peut sortir, les gars ! On peut sortir ! gueule la voix enfantine de Léonard. C'est lui qui secoue mon dos. Il a quitté le char pendant notre manœuvre. Il grimpe dans le boyau vertical maintenant, hérissé d'appareils, comme à un échafaudage.
— Y a des éboulis ! C'est une espèce de fossé ! Y a au moins vingt mètres, trente mètres ! avec des éboulis !
Là-haut, à la surface de la terre, notre division cuirassée, avec un son plus frêle que celui que nous entendions à l'intérieur du blindage, passe toujours… On dirait que les obus partent lentement, puis se précipitent pour arriver sur nous. Lorsque le sifflement commence, il semble toujours nous concerner, se diriger vers notre fosse. Des canons ne sont pas toujours pointés sur les fondrières camouflées. Mais il n'y a pas d'éboulis. Léonard délire, nous sommes tombés dans un entonnoir renversé. Non, le camouflage de la fosse a été crevé en son centre par le char; toute l'obscurité qui ne se trouve pas exactement sous ce grand trou plein d'étoiles semble converger vers lui. J'avance, je tâte : un peu plus loin, la paroi que nous avons attaquée s'incline… N'être pas tué avant de sortir ! Je n'ose pas allumer ma lampe électrique. D'ailleurs, je l'ai laissée dans le char.
— On peut essayer… dit Pradé tout près de moi dans l'obscurité.
Lui aussi est collé à la paroi : hors de nos blindages, nous nous sentons nus. Du mur de glaise, une odeur de champignons suinte, pleine d'enfance… Pradé frotte une allumette; elle n'éclaire qu'à deux mètres. Encore un sifflement qui s'approche de l'aigu au grave, se précipite; l'épaule enfouie dans la glaise, fascinés par le trou, le ciel que va remplacer la rouge illumination fulgurante, nous attendons une fois de plus. On ne s'habitue pas à mourir. L'allumette est extraordinairement immobile, et sa flamme halète. Comme un corps humain est vulnérable et mou ! Nous sommes plaqués au mur de notre fosse commune : Berger, Léonard, Bonneau, Pradé, — une seule croix. Notre bout de ciel disparaît, s'éteint, des mottes dégringolent sur nos casques et sur nos épaules.
Les vagues de chars passent toujours, là-haut, mais en sens inverse. Vient-on d'établir par ici le ravitaillement d'essence, ou sont-elles en retraite ? Ne sortirons-nous que pour tomber sur les colonnes blindées allemandes ? Je crois déjà que nous allons sortir…
La lampe électrique de Bonneau apparaît. Il ne hurle plus. Nous avançons, tous quatre, toujours collés à la glaise. Je suis redevenu calme, mais il est un coin de mon cœur que rien ne distrait, que rien ne distraira de l'obus. Le camouflage s'étend partout bien au-delà du trou qu'a fait le char en tombant; voici que la paroi effondrée monte en pente presque douce. Nous la gravissons jusqu'à nous heurter au tronc qui recouvre la fosse.
Les prisonniers
Jamais nous n'atteindrons le trou; nous sommes comme dans ces cachots qui ne prennent jour que par une trappe inaccessible : les prisonniers ne s'enfuient pas par le plafond. Il faudrait écarter les deux troncs les plus proches. Accroupis sous eux, chuchotant : «Un, deux, trois…» nous les éprouvons des épaules, pétrifiés en momie péruvienne par chaque explosion, mais revenus à nous aussitôt : depuis que nous pouvons agir, la peur est devenue action. Si nous ne pouvons rien contre les troncs, le char, lui, fera peut-être tout sauter. Il est derrière nous, silencieux, plus noir que la fosse; de sa porte entrouverte vient une raie de lumière où vole un insecte nocturne…
L'évasion
Nous nous y précipitons sans nous abriter, le retrouvons comme une forteresse. Pradé manœuvre pour se placer devant l'effondrement. La terre meuble s'y est accumulée. Les vagues, là-haut, continuent à refluer vers les lignes françaises… Nous, nous commençons à nous enliser. Pradé rabat sous les chenilles la poutre de secours; le char se dresse, tâtonne : les chenilles s'agrippent comme des mains. Le char monte encore, se bloque, patine encore, engagé, coincé dans le plafond de troncs. Si celui-ci ne cède pas, notre effort nous enfoncera de plus en plus; avant deux minutes, le corps du char sera collé à la terre et les chenilles tourneront à vide.
La poutre de secours est cette fois inemployable.
— Allons chercher des pierres !
Pradé ne répond pas.
Pleins moteurs, la masse d'acier vibrante s'enfonce dans les troncs, tout le blindage se roidit; du furieux rétablissement des taureaux mourants, le char me lance comme une pierre contre la tourelle, dans un fracas sonnant de troncs en pluie sur blindage; à l'arrière, on crie, un casque sonne, et voilà que nous glissons comme une barque… Relevé, je repousse d'un coup de poing la tête de Pradé collée à l'épiscope, j'éteins : dans le miroir, à l'infini, la plaine libre…
(IV) Les survivants découvrent un matin du monde
Nous avançons de toute notre vitesse entre les explosions, ne pensant qu'aux fosses prochaines, chacun ratatiné à son poste. Il ne faut pas qu'un autre char tombe après nous. Je pense bêtement que j'aurais dû contourner la fosse pour rester devant elle, ou attendre notre remorque d'essence pour faire prévenir le commandant (mais nous devons avancer), ou allumer un feu (mais avec quoi ?) Et nous ne devons pas rester là, nous devons avancer ! S'arrêter, c'est échapper aux fosses; mais rien, en ce moment, ni le refus de courtes vagues de chars, ni le risque que courent les camarades qui nous suivent, ni celui que nous courons nous-mêmes, ne compte en face de l'ordre reçu : nous avançons. L'armée. Ce n'est pas du courage, c'est du réflexe. Et, pourtant, la nuit qui n'est plus le sépulcre de la fosse, la nuit vivante m'apparaît comme un don prodigieux, comme une immense germination…
Ce n'est pas pour cette fois
Quand nous arrivons au village, les Allemands l'ont évacué. Nous descendons. Pagaille partout. Nous avançons avec un étrange balancement que je commence à connaître, le mouvement de la dernière fatigue, quand les soldats marchent tête en avant, lèvre pendante, et ne voient plus clair. Notre char, mal camouflé (comme les autres), nous nous affalons dans la paille d'une grange. Devant ma lampe électrique un instant allumée, je vois Pradé, couché, empoigner la paille et la serrer comme s'il serrait la vie.
— Ce n'était pas pour cette fois-ci, dis-je.
Sans doute pense-t-il que le fiston s'en est tiré.
— La guerre n'est pas finie…, répond-il avec son éternel sourire de rancune. Il lâche la paille et ferme les yeux.
Peut-être redeviendrons-nous vivants demain.
Le matin est aussi pur que s'il n'y avait pas la guerre. C'est la fin de l'aube. Pradé m'a éveillé en se levant; de nous tous, il a toujours été le premier levé :
— Quand je serai mort, j'aurai bien le temps de rester couché !
Je pars à la recherche d'une pompe. L'eau froide ne m'éveille pas seulement du sommeil de la nuit, mais aussi de la fosse. A quelques mètres, Pradé regarde devant lui, sourit amèrement de ses trois dents et secoue la tête :
— Si on m'avait prétendu que je regarderais des poules et que je trouverais ça pas naturel, je l'aurais pas cru…
Il n'y a rien dans ce matin que je ne regarde, moi aussi, avec des yeux d'étranger. Les poules pas encore volées errent, en apparence ignorantes de la guerre, mais leur petit œil rond nous suit avec une sournoise prudence; tout près, quelques-unes picorent devant une grange où des soldats dorment. Ce sont elles que regardait Pradé : je regarde, moi aussi, ce picorement mécanique, ce coup sec de la tête déclenchée par un ressort, et leur chaleur semble envahir mes mains comme si je les y ferais serrées, la chaleur des œufs frais, – la chaleur de la vie : les bêtes sont vivantes, sur cette étrange terre…
Le temps où les bêtes parlaient
Nous marchons dans le matin sans paysans. Des canards de Barbarie, des pies, – des moustiques… Devant moi sont deux arrosoirs, avec leurs pommes en champignon que j'aimais quand j'étais enfant : et il me semble, soudain, que l'homme est venu des profondeurs du temps seulement pour inventer un arrosoir. Au-delà du passage tranquille ou furtif des volailles lâchées, un lapin russe au derrière trop lourd, essaie de filer comme un garenne; les meules brillent dans le matin, les toiles d'araignées étincellent de rosée; un peu hébété, je regarde longuement une fleur saugrenue, née de l'humanité comme les fleurs saccagées qui l'entourent sont nées de la terre : un balai…
Devant la fuite brusque et souple d'un chat, voici que je me sens stupéfait qu'existe cette fourrure convulsive. (Tous les chats s'enfuient, d'ailleurs. Les roquets, eux, restent là, comme ils l'ont fait peut-être quand sont arrivés nos chars.) Qu'est-ce donc en moi qui s'émerveille – mon sentiment constant, depuis que je suis éveillé, c'est la surprise – que, sur cette terre si bien machinée, les chiens agissent toujours comme des chiens, les chats comme des chats ? Des pigeons gris s'envolent, laissant sous eux le matou cramponné à l'extrémité de son bond inutile; ils décrivent dans le ciel de lumière marine un arc silencieux, le brisent et continuent, tout blancs soudain, dans une autre direction. Je suis prêt à les voir revenir, chasser en courant le chat qui s'envolera. Le temps où les bêtes parlaient, la louche poésie des plus vieux contes, on les rapporte avec soi de l'autre côté de la vie…
Ô vie, si vieille
Comme celui qui rencontre l'Inde pour la première fois, j'entends bruire sous cette profusion pittoresque tout un bourdon de siècles qui plonge presque aussi loin que les ténèbres de cette nuit : ces granges qui regorgent de grain et de paille, ces granges aux poutres cachées par les cosses, pleines de herses, de jougs, de timons, de voitures de bois, ces granges où tout est grain, bois, paille ou cuir (les métaux ont été réquisitionnés), tout entourées des feux éteints des réfugiés et des soldats, ce sont les granges des temps gothiques; nos chars au bout de la rue font leur plein d'eau, monstres agenouillés devant les puits de la Bible… Ô vie, si vieille !
Et si opiniâtre ! Dans chaque cour de ferme, du bois a été accumulé pour l'hiver. Nos soldats qui commencent à s'éveiller en allument leurs premiers feux. Partout des carrés de légumes, bien ordonnés… Il n'est rien ici qui ne porte la marque de l'homme. Des épingles de bois, sous le vent, dansent sur les fils de fer comme des hirondelles. Parfois, le linge suspendu n'est pas sec : des bas maigres, des gants de toilette, des bleus de cultivateurs et d'ouvriers; dans cet abandon, dans ce désastre, les serviettes portent des initiales…
Nous et ceux d'en face, nous ne sommes plus bons qu'à nos mécaniques, à notre courage et à notre lâcheté; mais la vieille race des hommes que nous avons chassés et qui n'a laissé ici que ses instruments, son linge et ses initiales sur des serviettes, elle me semble venue, à travers les millénaires, des ténèbres rencontrées cette nuit, – lentement, avarement chargée de toutes les épaves qu'elle vient d'abandonner devant nous, les brouettes et les herses, les charrues bibliques, les niches et les cabanes à lapins, les fourneaux vides…
(V) Ceux qui survivent à la guerre naissent pour la seconde fois
Mes jambes se souviennent des bras de Bonneau qui les serraient, ses cris sous le martèlement du char, vibrent encore comme des mouches. Connais-je pour toujours cette tête d'enfant que je n'avais jamais vue à Pradé, ce visage stupéfait de Bonneau, coupant un hurlement pour dire «Moi ! Je crie pas !» ? Mais ces fantômes ne sont devant les granges, devant le soleil qui frissonne à l'extrémité des jeunes branches, que pour leur donner plus d'éclat.
La condition humaine
Une fois de plus Pascal me revient à la mémoire : «Qu'on s'imagine un grand nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables… C'est l'image de la condition des hommes.»
Combien une telle méditation peut crisper les hommes sur leur pauvre part de bonheur. Je me souviens de mon père… Peut-être l'angoisse est-elle toujours la plus forte; peut-être est-elle empoisonnée dès l'origine, la joie qui fut donnée au seul animal qui sache qu'elle n'est pas éternelle. Mais, ce matin, je ne suis que naissance. Je porte encore en moi l'irruption de la nuit terrestre au sortir de la fosse, cette germination dans l'ombre tout approfondie de constellations dans les trous des nuages en dérive; et, comme j'ai vu surgir de la fosse cette nuit grondante et pleine, voici que se lève de la nuit la miraculeuse révélation du jour.
Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer. Et de regarder ses formes qui ne sont, devant moi, que celles d'un village abandonné, condamné; de regarder ces granges de Paradis et ces épingles à linge, ces feux éteints et ces puits, ces églantiers épars, ces ronces voraces qui peut-être dans un an auront tout recouvert, ces bêtes, ces arbres, ces maisons, je me sens devant un don inexplicable, – une apparition.
Tout cela aurait pu ne pas être, ne pas être ainsi. Comme toutes ces formes uniques sont accordées à la terre ! Il y a d'autres mondes, celui des cristallisations, des profondeurs marines… avec ces arbres aussi ramifiés que des veines, l'univers est plein et mystérieux comme un jeune corps. La porte de la ferme que je dépasse a été laissée ouverte par les fermiers en fuite : j'entrevois une chambre à demi pillée. Ah ! les Rois Mages n'ont pas apporté de présents à l'Enfant, ils lui ont seulement dit que, dans cette nuit où il arrivait, battaient sur de misérables lumières des portes entrouvertes, – entrouvertes sur la vie qui m'est révélée, ce matin pour la première fois, aussi forte que les ténèbres et aussi forte que la mort…
Sur un banc, deux très vieux paysans sont assis; la veste de l'homme est encore maculée des toiles d'araignées de sa cave. Pradé s'approche, souriant de ses trois dents dehors :
— Alors, grand'père, on se chauffe ?
A l'accent, le vieux a reconnu un autre paysan; il le regarde avec une sympathie distraite, comme s'il regardait en même temps plus loin. Les cheveux de la femme pendent en une pauvre petite natte grise, très serrée. C'est elle qui répond :
«Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire ? Vous, vous êtes jeunes, quand on est vieux, on n'a plus que d'l'usure…
Accordée au cosmos comme une pierre… Elle sourit pourtant, d'un lent sourire retardataire, réfléchi : par-delà un terrain de football aux buts solitaires, par-delà les tourelles des chars brillants de rosée comme les buissons qui les camouflent, elle semble regarder au loin la mort avec indulgence, et même – ô clignement mystérieux, ombre aiguë du coin des paupières – avec ironie…
Naissance
Portes entrouvertes, linge, granges, marques des hommes, aube biblique où se bousculent les siècles, comme tout l'éblouissant mystère du matin s'approfondit en celui qui affleure sur ces lèvres usées ! Qu'avec un sourire obscur reparaisse le mystère de l'homme, et la résurrection de la terre n'est plus que décor frémissant.
Je sais maintenant ce que signifient les mythes antiques des êtres arrachés aux morts. A peine si je me souviens de la terreur; ce que je porte en moi, c'est la découverte d'un secret simple et sacré.
Ainsi, peut-être, Dieu regarda le premier homme…
Télécharger les textes III, IV et V.