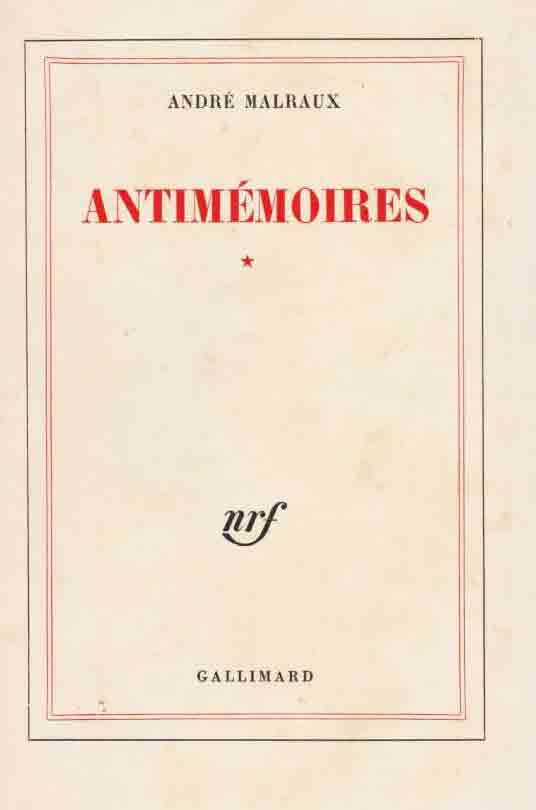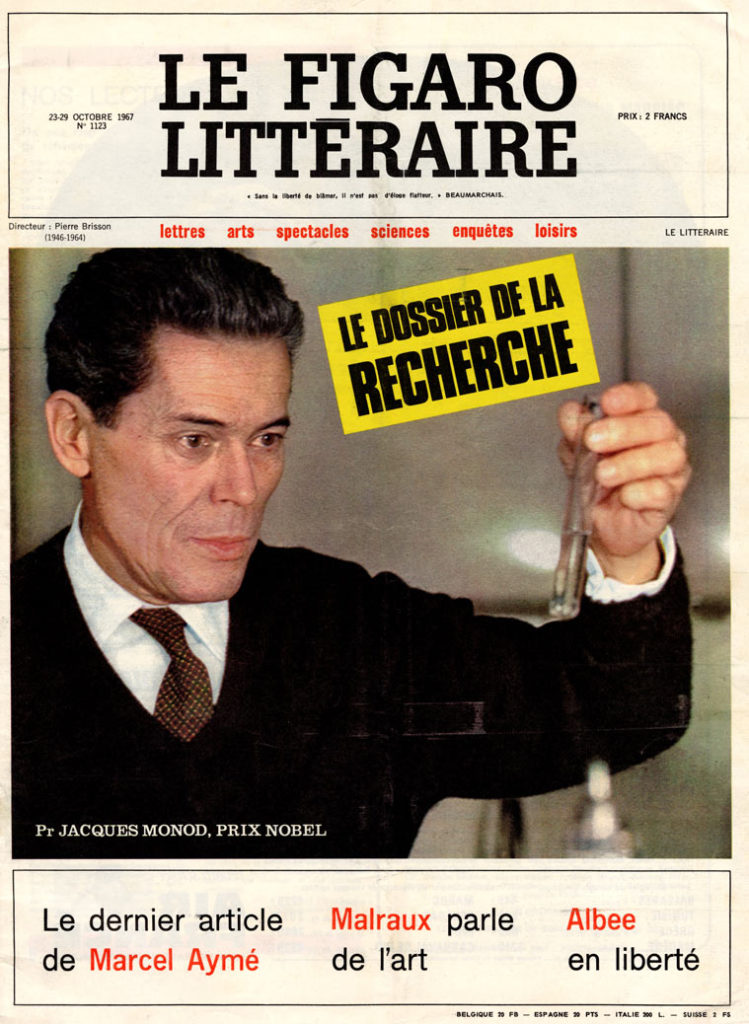André Malraux : «Un entretien exclusif avec Michel Droit : Malraux parle…», Le Figaro littéraire [Paris]. I : n° 1120, 2-8 octobre 1967, p. 6-9; II : n° 1121, 9-15 octobre 1967, p. 12-15; III : n° 1123, 23-29 octobre 1967, p. 12-15. (Trois livraisons.)
André Malraux, Michel Droit
Malraux parle…
Extrait 1 :
André Malraux — Absolument pas. Ce livre est entièrement le résultat d'une sorte d'accident. Je ne prévoyais pas du tout que j'allais me remettre à écrire au moment où j'ai commencé à le faire. Je ne prévoyais pas que j'écrirais ce livre qui s'appelle Antimémoires. Il y a là quelque chose d'assez rare et d'assez saisissant car, en définitive, pour mes autres livres, j'ai toujours écrit ce que je voulais écrire et quand je le voulais. Mais là il y a eu l'accident absolu.
Comment cela s'est-il passé ?
Pratiquement, il se trouve donc que je veux soudain exprimer l'expérience de ma vie. Mais, en même temps, il se trouve aussi, pour les raisons que vous savez, que je suis assez hostile aux Mémoires, aujourd'hui. Attention, la critique me fait dire que je suis fondamentalement hostile aux Mémoires. Ce n'est pas vrai. Je le suis maintenant.
J'ai toujours admiré Chateaubriand. Mais j'ai toujours été également frappé de la surprise éprouvée par ses contemporains lorsqu'ils furent en face des premiers fragments des Mémoires d'outre-tombe.
Les Mémoires d'outre-tombe c'est, en effet, quelque chose d'extrêmement singulier par rapport aux Mémoires. A une certaine époque on avait l'idée de deux sortes de Mémoires. D'un côté il y avait saint Augustin, c'est-à-dire Les Confessions. De l'autre côté il y avait Saint-Simon. En d'autres termes, il y avait des gens qui parlaient de ce qu'ils avaient vu, ou bien des gens qui parlaient de la façon dont ils avaient vécu. En une meilleure formule, je dirais : il y avait ceux qui écrivaient les Mémoires des spectacles qu'ils avaient rencontrés.
Chateaubriand fait quelque chose de tout à fait différent, bien qu'il commence biographiquement, puisque tout de même il y a Combourg, il y a sa mère, il y a le fantôme de son père. Mais bien qu'il fût un homme dont la vie était remplie d'histoires de femmes, il n'y a pas de femme dans les Mémoires d'outre-tombe. Pauline, on ne sait même pas qu'elle a été sa maîtresse. Quant à sa correspondance avec Mme de Récamier, c'est une correspondance, un point c'est tout. La différence géante avec, disons Les Confessions de Rousseau, a dû surprendre énormément.
Je me suis donc trouvé écrivant absolument «de chic» l'histoire de la chambre dans laquelle Hitler préparait ses discours de Nuremberg et que j'avais visitée tout de suite après la guerre, alors que je commandais encore la brigade Alsace-Lorraine. Et c'est à ce moment que j'ai eu tout à coup le sentiment qu'il y avait là quelque chose d'extraordinairement intéressant pour moi. Au lieu de chercher une chronologie, puisque j'étais contre la chronologie, au lieu de chercher une analyse intérieure puisque cette analyse intérieure ne m'intéressait pas, c'était de prendre tout ce qui dans la mémoire recoupait d'une façon ou d'une autre le Destin.
En définitive, l'Antiquité a tous les dieux que nous savons, et puis au-dessus, il y a ce dieu, sans temple et sans offrandes, qui est le Destin. Si je partais donc de cette volonté, je pouvais avoir, pour mon livre, une architecture intérieure extrêmement forte qu'on ne distinguerait probablement pas très bien au début, mais qu'on verrait clairement plus tard. Et cette architecture justifiait le livre, de la même façon que la conception qu'il a de lui-même a justifié, pour Chateaubriand, la structure des Mémoires d'outre-tombe, dont vous savez comme moi combien elles ont été attaquées.
Michel Droit — Quand vous vous êtes remis à écrire, vous l'avez donc fait sans préméditation, si j'ose dire. Mais vous avez tout de suite pressenti la forme qu'allait prendre ce que vous écriviez, à savoir ce recoupement du destin par certains éléments de la mémoire. Cela se passait où et quand ?
André Malraux — Il y a deux ans, sur le bateau qui me ramenait en Chine. Là, il y a un lien possible. Je savais que j'allais revoir un monde prodigieusement changé. Pensez ! j'étais déjà retourné en Extrême-Orient par avion. Mais le voyage que je refaisais par le bateau était celui de mon adolescence. C'étaient les mêmes escales. Déjà, au Caire, j'avais été impressionné par la transformation d'une ville de deux cent mille habitants en une métropole de deux millions d'âmes. Quand on le dit, c'est extrêmement banal. On sait bien que les villes grandissent, meurent. Mais quand vous le vivez, c'est une expérience étonnante. C'était toute mon adolescence qui, de ville en ville, repassait, complètement métamorphosée.
Le plus fort, c'est d'ailleurs que ce n'était pas pour aller voir Mao que je m'étais embarqué, mais parce que j'étais malade. Je devais alors faire des travaux assez secondaires au Japon. Et puis, les événements sont devenus tels que le général de Gaulle m'a télégraphié d'aller à Pékin.
Oui, je crois vraiment que, matériellement, mon livre part de là.
Extrait 2 :
Michel Droit — Quand vous vous êtes remis à écrire, vous l'avez donc fait sans préméditation, si j'ose dire. Mais vous avez tout de suite pressenti la forme qu'allait prendre ce que vous écriviez, à savoir ce recoupement du destin par certains éléments de la mémoire. Cela se passait où et quand ?
André Malraux — Il y a deux ans, sur le bateau qui me ramenait en Chine. Là, il y a un lien possible. Je savais que j'allais revoir un monde prodigieusement changé. Pensez ! j'étais déjà retourné en Extrême-Orient par avion. Mais le voyage que je refaisais par le bateau était celui de mon adolescence. C'étaient les mêmes escales. Déjà, au Caire, j'avais été impressionné par la transformation d'une ville de deux cent mille habitants en une métropole de deux millions d'âmes. Quand on le dit, c'est extrêmement banal. On sait bien que les villes grandissent, meurent. Mais quand vous le vivez, c'est une expérience étonnante. C'était toute mon adolescence qui, de ville en ville, repassait, complètement métamorphosée.
Le plus fort, c'est d'ailleurs que ce n'était pas pour aller voir Mao que je m'étais embarqué, mais parce que j'étais malade. Je devais alors faire des travaux assez secondaires au Japon. Et puis, les événements sont devenus tels que le général de Gaulle m'a télégraphié d'aller à Pékin.
Oui, je crois vraiment que, matériellement, mon livre part de là.
Michel Droit — Mais n'avez-vous pas aussi choisi cette histoire de la Reine de Saba parce qu'elle avait correspondu chez vous à une grande révélation d'ordre presque cosmique : l'avion, la tempête, le survol du désert et de la montagne ? …
André Malraux — Pas du tout. Je vais peut-être vous décevoir, mais je l'ai prise, au contraire, parce que je voulais mettre des éléments farfelus dans ce livre, et que cette histoire est d'une qualité farfelue assez étendue qui arrive au bon moment.
Michel Droit — En tout cas, il n'y a pas d'Espagne dans les Antimémoires.
André Malraux — Il n'y a pas d'Espagne, en fait, parce que le poids de L'Espoir est très lourd. Retrouver les choses véritablement importantes – j'entends dans l'ordre du destin – qui ne figurent pas du tout dans L'Espoir, j'espère le faire, mais ce sera tout de même assez difficile. J'ai pourtant le sentiment que dans d'autres livres il y aura l'Espagne. Comment y sera-t-elle ? Est-ce que je serai obligé de reprendre des morceaux de L'Espoir quoi qu'il arrive, même en les transposant, ou est-ce que je pourrai faire ce que je voudrais faire ? Cela dépend de beaucoup de choses. Pour cela, il faudrait d'abord que je retourne en Espagne. De même, il n'y a pas la Russie, parce que je ne suis pas retourné en Russie. Alors, pour l'instant, je laisse de côté les pays où je ne suis pas retourné…
En réalité, je n'ai pas du tout cherché à faire une totalité. J'ai plutôt cherché à suivre mon bateau. C'est un peu le réflexe conditionné qui a agi comme pour le chien de Pavlov. On approche du chien un morceau de sucre et il commence à saliver.
Michel Droit — L'Indochine non plus, vous n'y êtes pas retourné. D'où son absence ?
André Malraux — Pour l'Indochine, il s'est passé une chose assez comique. Vous savez qu'à l'heure actuelle un accident de bateau c'est incroyablement rare. Or, dans le détroit de Singapour, notre bateau, il s'appelait «Le Cambodge», a été percuté par un pétrolier, si bien que j'ai été obligé de rester à Singapour, le bateau ne continuant pas sa route. J'ai pris alors l'avion pour Hong-Kong, notre ambassadeur m'ayant télégraphié à Singapour de ne pas venir en Indochine. Ce qui fait que, n'y étant pas retourné, c'est David de Mayréna, enfin Clappique, qui fait la soudure avec elle. Mais ce n'était pas prémédité. Je pense que l'Indochine, j'irai.
Extrait 3
André Malraux — Mao, c'est le genre visité. Il est visité par la Chine. Pas de question. Quel que soit l'objet de la conversation, il est cordial, la conversation est cordiale, mais il y a quelque chose d'autre. Un peu comme chez le général de Gaulle. J'avais déjà rencontré cette présence intense que possède le général de Gaulle et que les paroles n'expriment pas. Je l'avais rencontrée chez de grands religieux. Les grands religieux non seulement sont cordiaux, mais ils sont même beaucoup plus. Ils sont bienveillants, chaleureux. Et vous sentez très bien, chez certains grands types religieux, que cette chaleur, cette affectation ne sont pas feintes. Elles sont vraies. Et cependant il y a quelque chose d'autre. Il y a le domaine de Dieu.
Michel Droit — Mao est visité par la Chine comme de Gaulle est visité par la France ?
André Malraux — Absolument.
Michel Droit — Parmi les hommes d'Etat étrangers que vous avez rencontrés au cours de vos missions, et dont vous rapportez les propos dans ce premier tome des Antimémoires, il semble que ce soit Nehru qui vous ait le plus impressionné ?
André Malraux — Non, mais c'est celui avec qui j'ai eu à parler le plus de choses qui ne soient pas politiques. Il y a donc une dimension supplémentaire. Après tout, je n'aurais guère pu parler avec Mao des problèmes du taoïsme, parce qu'il s'en fiche. Mais supposons que ce ne soit pas le cas. Supposons, par exemple, que j'aie revu Mao à un certain moment et que nous ayons parlé poésie. J'aurais tout de suite atteint une dimension supplémentaire.
Extrait 4 :
Michel Droit — Dans vos livres, il est souvent question des prêtres, des aumôniers, et même de Dieu, de l'Etre universel. Et cependant vous êtes agnostique. Vous dites que la religion n'a pas compté pour vous depuis votre confirmation. Mais on a l'impression que Dieu compte quand même. Ou alors, qu'est-ce qui compte ?
André Malraux — La transcendance. La notion de transcendance.
Procédons par ordre.
En ce qui concerne les prêtres, la réponse serait celle-ci : il faut toujours savoir qui on a vu. Vous vous souvenez de la phrase de Renan : «Je n'ai jamais connu que de bons prêtres». Les prêtres que j'ai connus étaient surtout des aumôniers, des prêtres combattants. Bon. Or vous savez comme moi que des aumôniers qui ne soient pas des hommes dignes de respect, c'est très rare. Disons donc que mon expérience du prêtre, quelle que soit sa religion, a toujours eu lieu dans des conditions positives. C'est le premier point.
Second point, il y a entre le prêtre et la vie une distance, et de toute évidence cette distance est du côté de la noblesse. Je suis sensible à cela.
Troisième point. L'essentiel. Il est bien entendu que je ne peux concevoir l'homme que fondé sur ce que j'appellerai le sentiment de servitude. Le sentiment de servitude, cela englobe tout ce qui dans la vie est de l'ordre du destin. En particulier la mort. Mais pas la mort en tant que trépas, car sous cet angle la mort m'est indifférente. Le fait que la mort existe. C'est-à-dire tout ce qui dans ce domaine nous est étranger et que nous subissons. Bon.
Le fait de ressentir la condition humaine, je dirai que c'est l'une des définitions de l'homme. Et le fait de ressentir la servitude humaine amène inévitablement à une recherche de ce qui s'oppose à la servitude. Or, ce qui s'oppose à la servitude, c'est évidemment le facteur mystérieux que la transcendance fait naître dans l'homme. Je ne dis pas que ce soit la transcendance en elle-même, car il est difficile d'en parler : c'est simplement le fait qu'elle soit présente.
Ajoutez que j'ai longtemps réfléchi sur l'art, et que sur ce terrain-là je suis en quelque sorte contraint à la transcendance. Dans l'édition définitive des Voix du silence que l'on va publier dans un an, je pousse l'idée jusqu'au bout. Cela consiste à dire : on a admis pendant des siècles que la grande référence était la nature et qu'il s'agissait de reproduire ce qu'on voyait en l'imitant ou en l'idéalisant. Or je crois que le style, c'est exactement le contraire de ce qu'on peut voir.
Toute œuvre d'art est à la fois quelque chose qu'on pourrait voir et quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce qui fait qu'il y a un art égyptien, c'est que le bonhomme que vous regardez sculpté dans la pierre est un portrait, mais c'est aussi bien le portrait d'un mort que celui d'un homme éternel. C'est un double. Or si ce n'était pas un double, le style ne serait pas le même. Et l'histoire de l'art qui, pour moi, n'est pas une histoire, mais l'énorme aventure de l'art à travers les millénaires, l'histoire de l'art c'est que les hommes aient toujours demandé à l'art la présence de ce qui n'est pas ce qu'ils peuvent atteindre.
Alors si maintenant nous nous en tenons rigoureusement à l'art, il est tout à fait clair que ce que j'oppose à la référence à la nature, c'est la transcendance.
Les Noirs d'Afrique ne croient pas que les ancêtres ont la forme des fétiches. Mais le fétiche, avec la forme qu'il a, est symbole de l'ancêtre, c'est-à-dire qu'il crée le langage de l'ancêtre. A quoi cela nous amène-t-il ? A retrouver, à travers toute l'aventure de l'art, la transcendance comme la donnée symétrique de la non-transcendance. Autrement dit, il n'y a art qu'à partir du moment où quelque chose s'oppose à la réalité. Ce quelque chose, les hommes ne l'ont trouvé que dans la transcendance.
Nous sommes d'ailleurs les premiers pour qui cela ne soit pas toujours le cas, puisque l'art abstrait ne se réfère pas à une transcendance. Mais, au bout du compte, je pense qu'il se réfère au musée imaginaire, c'est-à-dire à la totalité des œuvres. La bonne peinture, c'est de la peinture qui est bonne en face des autres bonnes peintures.
Extrait 5 :
Michel Droit — Oui, mais sur un plan plus général, c'est une question que ceux pour lesquels Malraux, c'est d'abord l'écrivain, peuvent se poser. Est-ce que cela vous amuse d'être ministre ?
André Malraux — Alors, disons qu'il y a une chose qui me passionne : c'est de pouvoir faire les Maisons de la culture. Je vous en parle parce que là où il y en a, tout le monde est au courant, mais là où il n'y en a pas, personne ne les connaît. Quand vous arrivez à Amiens, vous allez au musée, il y a quatre personnes. Mais si vous avez une exposition à la Maison de la culture, il y en a quatre mille. Et le premier soir il en est passé vingt mille. Quand vous êtes à Bourges, où la pauvre Marie Dorval n'a pas pu jouer faute de spectateurs et que vous voyez un public qui vient pour applaudir la Comédie-Française elle-même, parce que la salle est plus grande, vous vous dites qu'à partir du moment où l'on fait une Maison de la culture dans une ville de cent mille, deux cent mille habitants, c'est l'âme même de la ville qui est changée.
Alors naturellement, il faut recourir aussi à quelques astuces. De même que la mosquée est un lieu où l'on parle, mais pas seulement de Dieu, de même la Maison de la culture est un endroit où il importe que les gens aient envie d'aller tout à fait tranquillement prendre leur verre de préférence au bistrot. Mais nous savons qu'ils n'y vont pas seulement prendre leur verre, puisque dans la salle de théâtre on ne prend pas de verre et que celle-ci est pleine. Qu'une Maison de la culture puisse donc changer la vie d'une ville moyenne, j'en ai la certitude.
Or si nous arrivons à changer l'existence de la moitié des villes moyennes de France, ce qui est très possible, le reste viendra de lui-même, comme lorsqu'on a nettoyé la moitié de Paris, le reste a suivi. Parmi les choses auxquelles j'ai consacré une partie de ma vie, celle-là est donc importante à mes yeux.
Extrait 6 :
Quand vous êtes à Bourges et que vous voyez cinquante ou soixante paysans arrêtés pile devant des Braque, et pas du tout en train de rigoler, c'est tout de même très impressionnant. Bien sûr, je ne vous dirai pas qu'entre le moment où ils sont arrivés là et celui où ils en partent ils ont compris ce qu'est la peinture de Braque. Mais, en définitive, ce genre de confrontation joue le même rôle qu'on joué jadis les journaux féminins.
Il y a cinquante ans, une fille paysanne était habillée en noir toute sa vie. C'était comme ça et pas autrement. Et puis, à partir du moment où elle a lu les journaux parisiens, elle s'est aperçue qu'il y avait des patrons qui lui permettaient de s'habiller différemment. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Paris en automobile et faire cinq cents kilomètres dans n'importe quelle direction, vous ne trouverez plus une jeune paysanne habillée comme jadis. Il s'agit pour nous d'opérer une métamorphose semblable dans le domaine de la culture. Il faut que la Ve République fasse pour la culture ce que la IIIe a fait pour l'enseignement.
Extrait 7 :
Michel Droit — Mais vous, quel est le premier livre qui ait compté quand vous aviez quinze ans ?
André Malraux — Macbeth. Mais pour des raisons quasi psychanalytiques : spectres, corbeaux, forêt qui marche, somnambule… Aujourd'hui encore, pour moi, le héros de Macbeth, c'est le brouillard, et j'ai rêvé d'un film dont les personnages «émergeraient»… Pourtant je comprenais fort bien qu'il ne s'agissait pas d'un roman noir : «Tous les parfums de l'Arabie…», ces passages rejoignaient mon admiration pour Victor Hugo. Mais j'étais frappé par la puissance légendaire de Macbeth comme je l'ai été plus tard par celle de l'Orestie.
Extrait 8 :
Michel Droit — A la page 178 de vos Antimémoires, quand vous évoquez votre mission en Guyane, vous avez cette phrase : «Dire que j'avais été romancier»…
André Malraux — Cela veut dire que ce jour-là, vraiment, les dieux m'en donnaient plus que dans un roman.
Extrait 9 :
Prenez des collectionneurs de papillons, des farfelus complets, sachant à peine qui est le général de Gaulle, M. Mitterrand, M. Mendès-France ou M. Waldeck Rochet.
Télécharger le texte (31 pages)