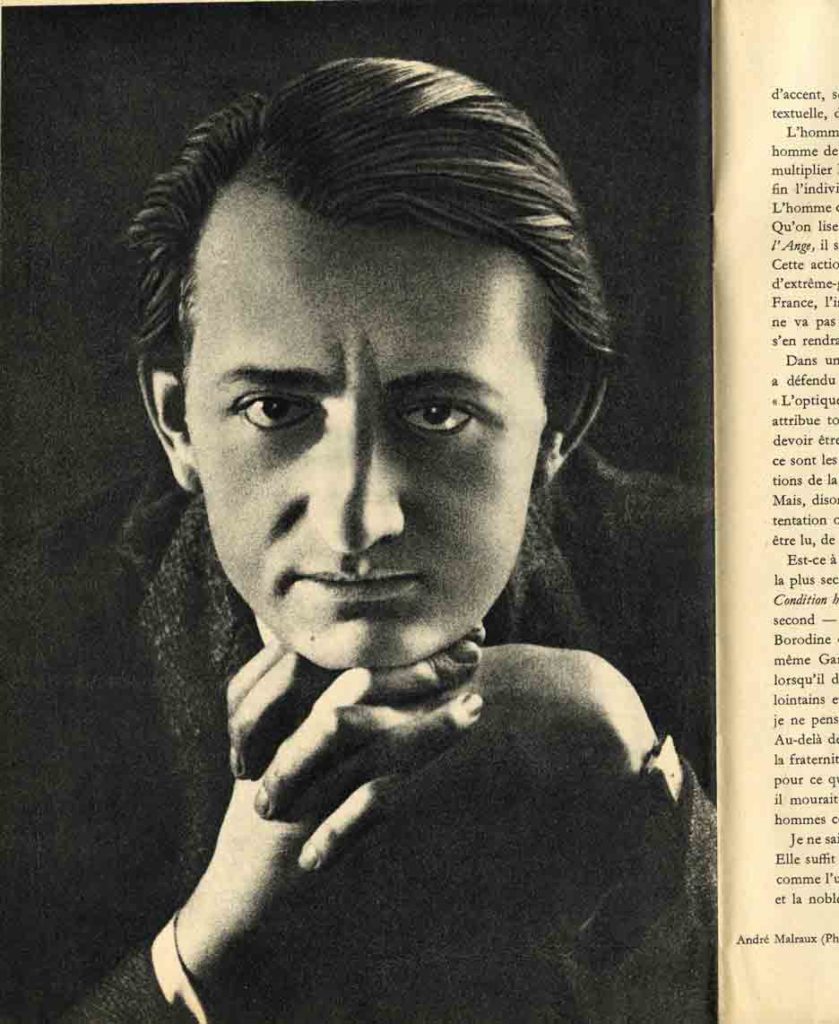Charly Guyot, «André Malraux», La Guilde du Livre, septembre 1948, p. 217-219.
Il y a trois ans, au moment où la guerre s'achevait, Malraux faisait, dans Labyrinthe, la déclaration suivante : «je ne sais si la littérature française ne comptera pas dans le monde nouveau avant tout pour son accent pascalien. Comment Malraux entend-il cette expression ? Disons tout de suite qu'il serait faux de l'interpréter dans un sens strictement chrétien. Dès le début de sa carrière, dès Tentation de l'Occident, l'écrivain affirme : «Dieu est mort». Parlant du christianisme, il dit résolument : «Je ne m'abaisserai pas à lui demander l'apaisement auquel ma faiblesse m'appelle.»
Mais toute l'œuvre de Malraux s'organise autour d'un problème central : celui de la condition humaine. Il le constate dans La Lutte avec l'Ange : «Par quoi suis-je obsédé depuis dix ans, sinon par l'homme ?» Problème qui est aussi celui de Pascal. Interrogation qui, à chaque page, s'élève des Pensées. Le drame essentiel de toute vie, c'est celui qu'évoque Gisors, celui «de tous ces êtres inconnus qui marchent vers la mort, dans l'éblouissant soleil, chacun choyant au plus secret de soi-même son parasite meurtrier. Tout homme est fou… mais qu'est une destinée humaine, sinon une vie d'efforts pour unir ce fou et l'univers !» Et Pascal à son tour : «Qu'on s'imagine un grand nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables… C'est l'image de la condition des hommes.»
L'accent pascalien, pour Malraux, c'est la résonance tragique d'un tel texte. C'est ce composé de faiblesse et de grandeur, de courage et de désespoir, cette vivante contradiction, cette «flamboyante absurdité», sur quoi l'homme fonde sa noblesse et appuie ses seuls véritables triomphes. Accent pascalien, mais non pas solution pascalienne. Pour l'homme de Port-Royal, le péché originel explique seul la misère de notre condition, et seule aussi la grâce divine nous sauve de cette misère. Malraux n'entend pas – ne veut pas entendre – cette explication. Pour lui, «dans la prison dont parle Pascal, les hommes sont parvenus à tirer d'eux-mêmes une réponse qui envahit d'immortalité ceux qui en sont dignes.» Il dit bien : «tirer d'eux-mêmes», excluant ainsi toute transcendance et tout sacrifice d'un Dieu qui nous rachèterait de notre condition. L'homme est seul, en face d'un univers absurde. Le plus bel effort qu'il puisse accomplir est peut-être de prendre conscience des fatalités de son destin. Les héros les plus proches du cœur de Malraux atteignent, en définitive, à la sérénité : elle naît de l'accord de l'être avec l'univers, dans l'acceptation de la mort. Et chez quelques privilégiés – les grands penseurs, les maîtres de la littérature et des arts – la capacité de création apparaît comme un inexplicable triomphe sur l'absurde : «Le plus grand mystère n'est pas que nous soyons jetés au hasard entre la profusion de la matière et celle des astres; c'est que, dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant.» Cette phrase, si proche de celle que je viens de citer, et si pascalienne d'accent, se lit dans La Lutte avec l'Ange. Il est significatif de voir Malraux la reprendre, textuelle, dans sa récente Psychologie de l'Art.
L'homme de Malraux, au contraire de Pascal qui condamne le «divertissement», est un homme de l'action. Il ne se connaît que dans l'action. Et ici de nouveau, il serait facile de multiplier les textes : «L'homme est ce qu'il fait». Ou encore : «Ce n'est pas à gratter sans fin l'individu qu'on finit par rencontrer l'homme». Ceci enfin : «Assez d'introspection ! L'homme commence à l'autre.» De là un caractère commun à tous les romans de cet écrivain. Qu'on lise Les Conquérants, La Condition humaine, Le Temps du Mépris, L'Espoir, La Lutte avec l'Ange, il s'agit toujours d'élucider «le rapport entre des individus et une action collective». Cette action, c'est tantôt la révolution communiste en Chine, tantôt la lutte des militants d'extrême-gauche contre l'hitlérisme naissant, tantôt encore la guerre d'Espagne ou, en France, l'invasion de 1940. Thème sans cesse repris, avec variations brillantes, mais qui ne pas sans entraîner, dans la construction romanesque, une certaine monotonie. On s'en rendra compte, si on lit, à la suite, Les Conquérants, La Condition humaine et L'Espoir.
Dans une lettre peu connue, publiée en 1931 dans la Nouvelle Revue française, Malraux a défendu contre Trotsky, qui avait critiqué Les Conquérants, sa position de romancier. «L'optique du roman, lisons-nous domine le roman.» L'écrivain n'admet pas qu'on lui attribue toutes les idées qu'il prête à ses personnages. La déclaration qui suit me semble devoir être retenue : «Ce ne sont pas mes jugements que l'on trouve dans Les Conquérants; ce sont les jugements d'individus distincts, et surtout à des instants particuliers.» Les conditions de la fiction déterminent la diversité des personnages. Aucun de ceux-ci n'est Malraux. Mais, disons-le aussi, chacun d'eux exprime une tendance, une possibilité de sa nature, une tentation ou un vœu de son être profond. On fera bien, pour lire Malraux comme il doit être lu, de tenir compte de cette «optique de roman».